Pas de droits culturels pour les Tsiganes
La question Rom est-elle soluble dans le social ?
A propos de : Samuel Delépine, Atlas des Tsiganes, Les dessous de la question rom, Paris, Éditions Autrement, 2016 (2e édition)
L’Atlas des Tsiganes, paru une première fois en 2012,est un livre bref, comme le veut la collection où il paraît, mais plein d’informations utiles, un livre qui cartographie, au sens propre (avec les cartes établies par Alexandre Nicolas) et figuré, les discriminations dont les Roms, terme englobant qui tend désormais à s’imposer, furent victimes dans leur histoire tourmentée et, surtout, dont ils souffrent encore dans les pays où ils demeurent. Sa lecture est très intéressante et vraiment édifiante, car l'auteur, Samuel Delépine ne se contente pas de généralités mais passe en revue une série de situations précises, prises dans leurs coordonnées spatio-temporelles. Mais, si les questions sociales (accès au logement, à l’éducation, au travail, aux dispositifs de santé) sont très bien traitées, au moins concernant l’Europe en général et la France en particulier (les excursions hors d’Europe y sont assez rares), les questions culturelles et linguistiques s’y trouvent non pas niées, mais à peine effleurées, traitées en creux plutôt que de manière positive et cela est tout à fait révélateur, à mon sens, du problème général que Delépine a le mérite de poser, sans le trancher, mais non sans adopter un parti pris qu’il lui faudrait au moins expliciter. En effet, la manière dont ce problème crucial est posé et instruit dans ce livre me plonge dans la plus grande perplexité et me semble souffrir d’une façon bien française d’aborder l’altérité culturelle, par définition non soluble dans l’unité et l’unicité républicaines. Or cette altérité est à la fois vécue et perçue de manière radicale. Et pourtant, les membres des différentes communautés présentes sur le territoire, depuis des siècles (n’oublions pas que les premiers groupes arrivent au début du XVe) ou depuis quelques générations, voire depuis moins encore, se considèrent comme Français, le seul pays d’ailleurs que la plupart connaissent, s’ils sont nés ici.
Le problème est l’usage d’une catégorie à la fois unique et englobante de toutes les différences (Tsiganes, Roms), car d’une part elle escamote toute la diversité des modes de vie et des traits culturels, et d’autre part elle contribue à constituer ceux qui sont désignés ainsi en objets de discrimination, alors même qu’elle est utilisée pour les reconnaître et les valoriser. La catégorie de Tsigane et ses dérivées, dont l’auteur dit justement qu’elle est chez nous à l’origine de l’hypocrite statut administratif « de gens du voyage » (une catégorie ethnique camouflée derrière une mobilité mise en avant qui correspond fort peu à la réalité) a en effet servi à justifier l’esclavage, les internements, les répressions de toutes sortes et sert de fait, encore aujourd’hui, à justifier toutes les discriminations. Or, tel est bien le problème, en faisant des Tsiganes une catégorie ethnique transnationale pour développer des politiques de reconnaissance et de lutte antidiscriminatoire, comme la Communauté européenne et le Conseil de l’Europe s’y emploient, non seulement la diversité est sinon niée (car tel n’est pas le cas, quoi qu’en dise l’auteur) du moins minorée, mais surtout on sert, en quelque sorte sur un plateau, une identité toute faite aux anti-tsiganes dont ils n’ont qu’à inverser le sens pour produire des politiques nationales d’exclusion et de répression (voir Emmnuel Valls affirmant en 2013 que « les Roms » – alors que la France officiellement refuse un terme qui signifierait la reconnaissance d’une minorité en son sein – n’ont pas « vocation » à rester en France). Si je comprends bien, il vaudrait donc mieux éroder la catégorie, la relativiser, en nier la pertinence pour en finir avec l’ethnicisation des Roms et répondre à leurs difficultés sur le seul terrain social. Mais cela revient, fatalement, à développer des politiques assimilationnistes, car les mesures sociales ne sont évidemment jamais culturellement neutres, elles passent toujours par l’impositions de règles et de modèle culturels à ceux qui en sont les « bénéficiaires » et/ ou « les victimes ». Et c’est précisément parce qu’ils savent résister à cette acculturation forcée, parce qu’ils n’ont cessé de développer des stratégies pour s’y soustraire tout en affectant de s’y soumettre lorsqu’ils ne peuvent faire autrement, que les Tsiganes existent encore. Je m’aperçois qu’en disant cela je valide moi-même d’une certaine façon l’existence d’une catégorie unifiante, et je pense en effet que l’on n’y échappe que très difficilement.
Pour éviter cela, quoi qu’il conserve de fait lui-même une telle catégorie (son Atlas est celui des… Tsiganes justement !) l’auteur insiste sur les différences de conditions, de statuts, de modes de vie, de représentations identitaires, de modes d’expression, etc. tout en disant d’ailleurs que la langue romani (romani čib) est l’un des seuls points commun qui rassemble les Tsiganes, alors que (il le dit aussi, mais sans y insister) celle-ci est tellement diversifiée que l’intercompréhension ne peut être parfois spontanée entre les groupes, sans compter qu’en certains pays la langue est très largement perdue.
Mais il est un fait que, à travers toutes ses variations, il existe bien une langue, qui porte en elle l’attestation indéniable d’une source indienne (voir ici, Rencontre avec une langue invisible : le manouche). Celle-ci en effet n’est pas une pure « théorie » comme semble le dire l’auteur ; il y a bien une histoire, disponible aujourd’hui, certes inconnue des intéressés jusqu’à une époque assez récente (elle suscite d’ailleurs encore bien des perplexités parmi eux), qu’ils s’approprient peu à peu et à laquelle ils donnent des sens divers. Et pourquoi ne devraient-ils pas le faire, au motif qu’ils n’en seraient pas eux-mêmes les premiers découvreurs et qu’elle n’appartient pas à leur mémoire orale ? Certes elle les conduit à reconstruire, fatalement, nécessairement un (en fait à ce jour, plusieurs) récits des origines, et ceux-ci ne peuvent pas ne pas être largement mythiques et mythifiés. Mais il en va toujours ainsi et, avec notre propre roman national, nous n’avons aucune leçon à donner. Il en va de même de l’évidence factuelle de l’incorporation continue aux mondes tsiganes d’individus et de groupes non issus de l’Inde. Le grand récit de l’origine indienne n’est pas, pour eux, plus faux (ni plus vrai) que celui, par exemple, des origines gauloises du peuple de France.
Alors pourquoi, j’ai presque envie de dire de quel doit, s’opposer à cette « histoire commune » balbutiante, au motif que ce récit est exploité par ceux qui ont intérêt « à défendre l’idée d’une origine commune et d’un peuple uni autour de revendications nationales » (p. 10) ? Certes, il est vrai, comme Delépine le dit, que pour « la majorité des concernés […] l’identité n’est pas fondée sur une origine lointaine mais sur des pratiques culturelles bien identifiées au sein de familles elles-mêmes bien identifiées » (p. 11). Cependant il est aussi un fait que ce récit commun se répand peu à peu, et il me semble vain de le combattre en s’en prenant aux « leaders tsiganes » qui « militent aujourd’hui par intérêts politiques, pour la reconnaissance d’une minorité tsigane transnationale » (p. 11). Car enfin, tous les leaders nationaux du monde n’en font-ils pas autant ? Tous, tels qu’ils sont, instrumentalisent et au besoin inventent le discours des origines et le mettent aux services de leurs « intérêts politiques » et privés. Pourquoi ce qui est banal chez les autres, serait-il choquant chez les Tsiganes ? Pourquoi, à la différences des autres, leurs velléités (encore très limitées, particulièrement en France) à se constituer en nation ou en peuple n’auraient-elles aucune légitimité et ne sauraient-elle servir que les intérêts politiques ou économiques de leurs leaders ? (« Il est avéré, dit-il plus loin, que les leaders tsiganes ont vu dans les préoccupations européennes un moyen de soutenir leur cause et de la financer » p. 41).
L’auteur rappelle la création de l’Union romani internationale, en 1971, lors du premier congrès international des Roms, avec l’adoption de l’hymne Gelem, gelem (un chant d’ailleurs terrible et magnifique) et du drapeau portant la chakra, la roue, rappelant à la fois les origines indiennes et le voyage. Cette idée et son symbole (le drapeau) sont certes très loin d’être reconnus par ne fût-ce qu’une partie consistante des Tsiganes, mais ils font leur chemin, entre autres par un biais que l’auteur n’aperçoit pas du tout et qui est celui du pentecôtisme de Vie et lumières (mission tsiganes destinés à tous les voyageurs en tous les lieux du monde qui compte en France plus 100.000 fidèles), où l’on trouve de fait chez certains pasteurs un discours très essentialiste sur l’existence d’un seul peuple, attesté par la langue, qu’ils utilisent dans leur œuvres missionnaires à l'étranger. Et puis, il y a le fait, acté politiquement, du rôle consultatif reconnu aux représentants Roms à l’ONU depuis 1978 ainsi qu’au Conseil de l’Europe.
L’auteur remarque que, « à parler de minorité ethnique, voire de peuple, on en oublierait presque que les Tsiganes sont des nationaux – des Français, des Roumains, des Espagnols, etc. – et qu’ils vivent au gré des contextes socio-économiques locaux. » (p. 79). Certes, il sont de faits des nationaux, mais vu les difficultés qu’ils rencontrent et le rejet et les discriminations dont ils souffrent dans chacune des « puissances » (comme disent significativement les manouches français), comment peut-on oser reprocher à ceux qui le font de chercher à s’unir par dessus les frontières ? Je trouve choquant, tout simplement, que l’on puisse en juger ainsi, du dehors, alors que l’on trouvera tout à fait légitime, par exemple que les Kurdes puissent affirmer une unité transnationale. Le rapprochement avec les juifs s'impose aussi de lui-même et bien des Tsiganes ne manquent pas de le faire : n'ont-ils pas partagé d'ailleurs le même destin tragique, au moment de la deuxième guerre mondiale ?
De la même façon, l’auteur critique l’unification indue « sous le ‘label’ de la langue romani », qui transforme la « langue en culture » et permet ainsi la mise en place par l’Europe et certains États de « programmes roms » qui « desservent souvent les premiers concernés », (p. 33), toujours du fait que toute discrimination culturelle positive se retournerait en arme de discrimination massive. Mais d’abord, la langue n’a pas à être « transformée » en culture, elle l’est de part en part, même si bien sûr elle n’en est qu’un élément en même temps que le véhicule. Ensuite, s’il y a beaucoup à dire en effet sur les programmes européens ayant souvent largement échoué, il faut discuter la très fausse évidence selon laquelle « tout ce qui promeut une minorité […] à la fois, l’isole » ; au contraire une minorité est d’autant plus isolée, comme c’est le cas justement des communautés tsiganes, qu’elle est dévalorisée et non reconnue, niée jusque dans le fait qu’elle constituerait en effet une minorité, comme tel est le cas en France.
L’auteur dit lui-même que « les Tsiganes sont en revanche presque totalement absents quand il s’agit d’être acteurs de la société civile. Longtemps tenus à l’écart (voire rejetés) par les gadjé, ils ont limité leur parole. Et aujourd’hui, contrairement à d’autres minorités, ils tardent à investir le champ de l’action politico-sociale, notamment en Europe occidentale » (p. 40). L’une des raisons de ce manque d'investissement, pour ce qui est de la France en tout cas, est l’absence de toute possibilité de le faire, ni en tant qu’ethnie, ni en tant que communauté, ni en tant que minorité, ni en tant que nation, ni en tant que peuple, autant de notions proscrites pas le droit français et surtout inacceptables dans le discours publics, puisqu’il n’y a ici qu’une communauté reconnue : la « communauté nationale », qu’une nation, la nation française, qu’un peuple, le peuple français, etc… Ils n’ont donc d’autre choix que de se taire, voire, pour survivre, de dissimuler leur identité, phénomène général de tous les auto-entrepreneurs gitans ou manouches de France, et en fait la seule fenêtre de revendication qui reste ouverte, et qu’ils commencent à investir au grand scandale des pouvoirs publics (voir ici Le droit de pleurer ses morts), est celui des inégalités de droit les plus criantes (problèmes de stationnement par le refus de nombreux élus d’appliquer la loi Besson, refus de laisser un condamné assister aux funérailles d’un membres de sa famille, etc.).
Delépine critique les « programmes interculturels » à destination des Roms dans les pays où ceux-ci sont reconnus comme « minorités nationales », comme celui par exemple, dans la province serbe de Voïvodine, qui propose l’apprentissage du romani (137 élèves en 2007, une goutte d’eau !) : « la mise en valeur de la culture tsigane doit permettre l’échange et empêcher la stigmatisation des enfants roms à l’école ». Mais alors, dit l’auteur, la «' tsiganité' de l’élève est centrale, ce qui peut poser question » (p. 33)[1]. Tout processus conduisant à essentialiser une identité pose en effet question, mais serait-ce mieux de leur imposer l’identité serbe, comme on impose aux groupes vivant en France une francité exclusive (c’est-à-dire qui les inclut à condition de renoncer à leurs différences) ? Cela revient bien, en réalité, à nier une identité ethnique minoritaire pour lui en substituer une autre, tout aussi ethnique même si elle ne dit pas son nom, promue par le ou les groupes détenant le pouvoir politique et donc décidant des politiques scolaires, culturelles, linguistiques... En fait la question de fond, escamotée par un point de vue qui se donne pour universaliste (mais en fait au service de l’État nation) est celle, tout simplement, de la démocratie, qui reste un vain mot si elle ne se traduit pas par la reconnaissance non seulement des mêmes droits sociaux, mais aussi des mêmes droits culturels et linguistiques, c’est-à-dire des mêmes droits à cultiver et transmettre ses propres spécificités culturelles et linguistiques.
L’auteur doit bien reconnaître que la question ethnique, et donc culturelle est bien première dans le rejet partout, en Europe (et ailleurs), des communautés Roms. « En effet les problèmes et discriminations vécus par de nombreux Tsiganes sont liés à l’ethnicité et au rejet de ce qu’ils sont ethniquement parlant. Ceci est certain et l’ignorer serait une erreur d’analyse des contextes. Mais faut-il participer au maintien de la différenciation ethnique en relevant des bonnes pratiques censées résoudre des problèmes ? » (p. 88) Mais alors quoi ? Il faut nier les différences éclatantes (entre les communautés dites tsiganes et les gadjé), ou du moins faire comme si elles n’existaient pas, pour écarter toute politique culturelle à leur égard en se concentrant uniquement sur la question sociale : l’accès aux soins, à l’école, au travail, au logement ? Cela revient de fait non seulement à mettre de côté, mais à combattre les différences culturelles, et à les combattre activement, en imposant aux « voyageurs » les modes de vie et la culture nationale des « sédentaires ». Je le vois tous les jours : la scolarisation passe par une négation culturelle et linguistique pure et simple. Le français est enseigné de manière exclusive et aucun dispositif légal ne prévoit pour les enfants des « gens du voyage » (le terme même l’exclut a priori) un quelconque enseignement de leur histoire – ainsi ignorent-ils le plus souvent presque tout de leur propres tribulations et de leur propre diversité –, et bien sûr de leurs propres parlers (voir ici « On est en France, on parle français »). C’est-à-dire qu’une fois de plus, ils sont réduits au mieux à des objets de dispositifs d’aide sociale et caritative et, au pire, à des objets de rejet et de répression, sans être considérés comme des sujets culturels, dans leur différence, laquelle seule peut les élever à cette dignité de citoyens à part entière qui leur est, de fait, obstinément refusée.
Jean-Pierre Cavaillé
[1] Également : « Associer la thématique tsigane aux manifestations culturelles (et à la culture en général) peut être problématique. La « question rom » est une de ces constructions politiques que l’art et la culture tentent le plus souvent de mettre à bas. Mais ils peuvent avoir malgré eux des effets pervers (généralisations et clichés) qui participent à les entretenir » p. 39.

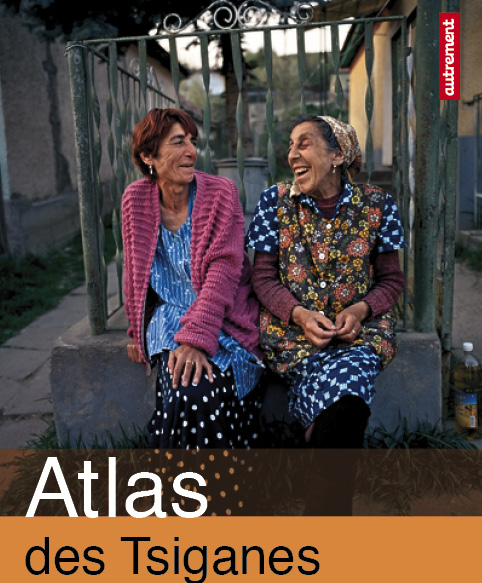


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F50%2F115864%2F121224661_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F74%2F63%2F115864%2F119168246_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F93%2F37%2F115864%2F53795225_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F51%2F115864%2F52516511_o.jpg)