Patois limousin, le retour !...
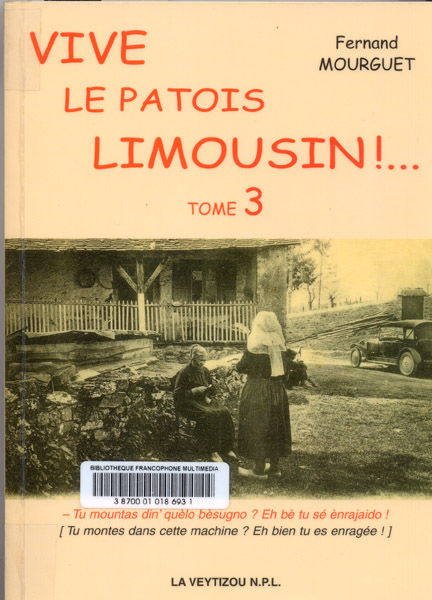
Patois limousin, le retour !...
Jamais deux sans trois. Fernand Mourguet vient de faire paraître un tome supplémentaire de sa grande saga patoisante : Vive le patois limousin !...[1] (ponctuation originale). Comme les précédents, il contient une gerbe (bauda évidemment) de textes les plus divers, que réunit l’adoption d’une graphie (et d'une ponctuation !...) personnelle(s) pour noter ce que l’auteur appelle le « patois limousin » : un dictionnaire « français-patois » (initiative tout à fait remarquable, qui semble impliquer que l’on puisse et même qu’il soit souhaitable d’enseigner le « patois limousin »), des expressions et proverbes, des transcriptions en sa graphie de chansons anciennes ou d’auteurs fameux (Mazabraud, Rebier, Pierre dau Faure), des Noëls et autres chansons religieuses (voire mêmes quelques prières), des poésies de son crû et toute une ribambelle de textes courts, baptisés « gnorlas », mais qui sont le plus souvent loin de répondre au comique plus ou moins grinçant du genre ; il s’agit plutôt des réflexions et opinions à bâtons rompus, des ébauches de fables, des bouts de rêveries de cet étonnant Pierrot lunaire. Tous les textes limousins sont suivis d’une traduction en français. Rien de toute cette matière n’est vraiment abouti, tout reste un peu en plan, en suspens, ni fait ni à faire ; ce livre me fait penser à une forme d’art naïf, pas des plus réussies, pleine de clichés un tantinet réactionnaires et mêmes franchement irritants[2], mais avec de petits détails bizarres qui excitent la curiosité et poussent en fait à poursuivre la lecture. Pourquoi donc Mourguet ne se lance-t-il pas dans la composition d’une vraie fiction ? D’un roman paysan par exemple ? Peut-être parce qu’il en juge indigne sa langue, qu’il chérit pourtant au plus haut point, la caressant du nom, doux à ses oreilles, de « patois ». Mais il l’aime comme il la croit être : pauvre, démunie, réduite au souvenir et à la plaisanterie… Sans doute pense-t-il que le roman ne s’écrit qu’en français, ou alors en « occitan », ce mot qu’il exècre tant. Mais à la fois, il ne peut s’empêcher de livrer au lecteur, en patois, de graves pensées et mêmes quelques poèmes sérieux et touchants, d’une religiosité en vérité fort peu orthodoxe[3].
J’ai déjà eu l’occasion de dire ce que je pensais de cette aventure graphique, répondant à la volonté d’écrire le « patois » sur le modèle du français afin – croit-on – de le donner à entendre (voir ici même, « Vive l’occitan limousin ! » et « La guerre picrocholine mais néanmoins meurtrière du patois contre l’occitan »). Mourguet ne veut pas comprendre qu’il ne peut rendre la variété de langue qu’il écrit qu’à « l’oreille » de ceux qui la connaissent déjà[4]. De plus, la base française de son système personnel de codification est tellement prégnante qu’il en oublie plus d’une fois le « patois » lui-même (n’écrit-il pas le présent de l’indicatif du verbe être à la troisième personne « est » ?). Mais Fernand Mourguet est obstiné et persévère dans ses choix. Cela est bien sûr son entière liberté et je lui suggère d’ailleurs de traiter le français comme il traite le limousin ; cela serait logique (en effet, il y aurait bien des réformes à accomplir pour en donner un code plus cohérent ; pourquoi se cantonner au seul « patois » ?) et rendrait ses livres amusants.
Mourguet, cette fois, pour la rédaction de son dictionnaire, s’est pourtant intéressé aux travaux des autres, et sa manière d’envisager la langue et de ce que l’on peut en faire me paraît en être quelque peu modifiée. En particulier, l’idée que ce qu’il appelle « patois » est une « vraie » langue, une langue à part entière, semble avoir fait son chemin. Dans son introduction ou préface, il cite d’ailleurs les noms de Maurice Robert et d’Yves Lavalade. Lavalade utilise, on le sait, la graphie occitane dite classique, Maurice Robert, lui, est partisan d’une graphie réformée, mieux adaptée aux spécificités phonétiques du limousin[5]. Je ne veux pas m’engager ici dans ce débat, très intéressant du reste, mais je note au moins ce qui rassemble Robert et Lavalade : tous deux considèrent que le limousin appartient à la langue occitane. Ce n’est pas le cas de Mourguet, qui ne veut entendre parler que de « patois », sans se prononcer sur ce que la langue est ou n’est pas. Car il n’est pas et ne veut pas être linguiste. Pourtant, il n’hésite pas, en vertu de son expérience de la langue, à vouloir en réformer la graphie. Mais cela n’exigerait-il pas aussi quelques compétences en linguistique ? Apparemment pas : il trouve sa légitimité – dit-il en substance –, non dans les savants prétendus, dont il se moque – gentiment ou pas –, mais dans les gens qui le lisent et qui lui disent : « Au moins on peut te lire, toi avec ton patois, mais pas les autres auteurs qui écrivent en occitan » (p. 14). « C’est réconfortant !... » ajoute-t-il. Pour lui, sans doute ; pour nous, qui essayons de diffuser une conscience linguistique à travers la graphie classique, c’est évidemment désespérant. Mais c’est ainsi. Il faut en prendre acte.
Par rapport au désaccord entre Lavalade (et faudrait-il ajouter au nom de celui-ci, ceux de tous les auteurs, c’est-à-dire tous ou presque, qui ont adopté la graphie classique) et Robert, Mourguet n’est pas très fair play, révélant que l’un lui aurait dit de l’autre : « Moi, je suis linguiste ; lui il est archéologue ». Robert, archéologue ? Mourguet veut-il dire « ethnologue » ? Enfin la question n’est pas là, d’autant plus que, grand seigneur, il affirme qu’ « il n’y aura jamais trop […] de limousinants de conviction, qu’ils soient d’obédience « robertienne », « mistralienne », « félibréenne », « occitanienne » ou même « patoisante » » (p. 12). Cet œcuménisme l’honore, et est chez lui chose nouvelle. Précisons cependant qu’il n’y a guère à ma connaissance de partisans de la graphie mistralienne en limousin et que les Félibres comme les autres, sauf Robert et – dans un autre style – Mourguet et les écrivains francophones édités par la même maison d’édition (La Veytizou), qui ponctuent leurs livres de phrases patoises, ont adopté depuis fort longtemps la graphie classique. C’est celle qui est enseignée à la calandreta, dans les collèges (là bien sûr où il y en a, c’est-à-dire presque nulle part), à l’université, dans les cours pour adultes de l'IEO etc… Cet œcuménisme apparent a en fait pour fonction d’introduire un petit texte de Robert, consacré au premier tome de Vive le patois Limousin, et que l’auteur reproduit fièrement en exergue, ce qui semble attester qu’il ne recherche pas seulement la satisfaction de ses lecteurs non pervertis par les écoles, mais aussi quelque reconnaissance du côté des savants linguistes, archéologues ou autres ethnologues… A la vérité, le court texte de Robert est plein de réserves : « Peu importe la graphie et même le terme « patois », le seul qu’aient connu jadis les paysans pour désigner leur langue. L’essentiel est de s’exprimer, d’écrire, de parler, c’est-à-dire de vivre sa culture. Notre parler disparaît assez vite sans que nous créions des blocages orthographiques en imposant une graphie réservée aux travaux de recherche » Ce à quoi, je souscris totalement, à cette nuance près que la graphie classique n’est certes pas réservée aux travaux de recherche : elle est utilisée pour écrire des romans, de la poésie (songeons quand même à Delpastre, à Melhau, à Berland, à Lavalade aussi, bien sûr), des articles de journaux et de revues, pour enseigner aux enfants, etc. Mais en effet,va pour le « patois » : si Mourguet veut utiliser ce terme, je n’y vois pour ma part aucun inconvénient.
Que l’on me permette cependant de signaler le malentendu le plus absolu, bien connu de tous ceux qui se sont intéressé à la question. Mourguet cite avec indignation la définition de « patois », donné par « un certain dictionnaire » (Lavalade ?) : « terme péjoratif, chez nous, pour désigner la Langue d’Oc ; son usage est à proscrire ». « Et l’on voudrait, s’écrit-il, que ceux qui aiment ce patois ne soient pas révoltés par ces propos ? » (p. 14). C’est que, pour Mourguet, le mot est inséparable de la chose, au point que la langue d’oc ne peut, ne saurait en aucune façon renvoyer à ce que lui nomme « patois ». Tellement qu’il va jusqu'à dire qu’écrire « patois » (c’est-à-dire, comprend-on dans sa propre graphie) risque de devenir, du fait de la fatwa occitane lancée sur le terme et sur les graphies patoisantes, une activité clandestine (« faudrait-il en arriver à écrire des samizdats ? », p. 15). Il envisage même de « planquer » ses manuscrits « dans les fissures, dans les failles des rochers d’une grotte limousine appropriée…, que l’on retrouverait dans des siècles », boutade qui dénote tout de même une légère paranoïa, car personne ne le persécute et ne songe à le priver d’éditeur ! Son livre, d’ailleurs, se vend comme les petits pains dans tous les supermarchés et les kiosques de la région… Pourtant il redoute une « levée de bouclier » et s’insurge contre les propos de ceux qui osent dire du patois qu’il est un terme dégradant : « Le patois est encore une langue chevillée au corps chez beaucoup. Ils ont droit eux aussi au respect » (p. 15). Mais est-ce leur manquer de respect que de leur dire que ce qu’ils appellent « patois » est en fait une « langue » à part entière (ce que dénie – pour la plupart de ceux qui l’emploient – le terme de patois), et que cette langue a un nom ? Dans un passage assez embrouillé, Mourguet déclare en fait que l’interdit du patois est venu deux fois : une fois de la part de l’école française et une seconde fois des occitanistes (qu’il appelle les « occitans ») : « ceux qui avaient enfin appris à lire et à écrire en français, quand apparut cet occitan de certains intellectuels » (p. 15). L’occitan est une langue d’intellectuels, opposée au patois du peuple… il y aurait une sorte de lutte de classe entre occitan et patois, si je puis traduire ainsi les propos on ne peut moins marxisants de Mourguet. S’il ne s’agissait pas de la même réalité linguistique, cela ne serait pas tout à fait faux, au sens où, en effet, les promoteurs de la graphie classique, de fait (mais comment aurait-il pu en aller autrement ?), appartenaient et appartiennent toujours à la petite (et grande) bourgeoisie, souvent citadine ou villageoise. Il faut bien reconnaître aussi que, globalement, même au plus fort de leurs années revendicatives, les composantes du mouvement occitaniste n’ont pas suffisamment investi le terrain de l’éducation populaire, de la formation des adultes et des enfants (Calandreta est apparue du fait même de cette déficience). Mais il est évident aussi que si l’école avait fait son travail, c’est-à-dire si elle avait diffusé la graphie classique, Fernand Mourguet et consorts ne la contesteraient pas plus qu’ils ne contestent l’orthographe française, pourtant bien moins régulière et « phonétique » ! Car ils ne contestent pas les institutions – c’est à peine si Mourguet ose faire le moindre reproche à l’école qu’il a connu – mais ceux qu’il est si facile de critiquer parce que justement ils ne sont pas parvenus à acquérir une légitimité institutionnelle. Autrement dit, les occitanistes ont bon dos. Quant au mépris des intellectuels (toujours doublé du désir éperdu d’être reconnu par eux) il vaut bien le mépris de l’immense majorité des intellectuels (et justement les occitanistes, pour la plupart, ne sont pas de ceux-là, qui souvent font de l’occitan par amour des cultures populaires) à l’égard des paysans et des ouvriers.
Mourguet affecte de reconnaître, mi-résigné mi-insurgé : « Il est vrai que je ne sais pas, que je ne veux pas, que je peux pas écrire et parler l’occitan… C’est une véritable impossibilité » (p. 15, c’est moi qui souligne). Cet aveu est surtout celui de la mauvaise foi : car ce que nous ne cessons de lui répéter, qu’il ne sait que trop et qu’il refuse de toute son âme, comme un malade refuse de reconnaître un diagnostic avéré, c’est qu’il parle déjà parfaitement occitan sans avoir à changer le moindre mot, la moindre intonation de son « patois ». Il est donc proprement absurde de dire qu’il ne peut ni ne veut parler l’occitan, et c’est bien sûr l’occitan qu’il écrit dans une graphie personnelle (de même que le français dont on réformerait l’orthographe ne cesserait bien sûr d’être du français), une variété de l’occitan limousin ; mais une fois encore l’occitan n’existe pas en dehors de ses dialectes, eux-mêmes soumis à variation. Aussi lorsque Mourguet affecte de s’élever avec véhémence contre la déclaration relevé sur internet (qui par bonheur dit-il, « ne m’est pas accessible », apportant la preuve manifeste du contraire), suite ajoute-t-il à « un article [le] concernant » (« La guerre picrocholine et néanmoins meurtrière du patois contre l’occitan », qu’il se garde d’ailleurs bien de discuter), selon laquelle « il vaut mieux cent personnes qui parlent occitan que cent mille personnes qui parlent patois », hé bien il passe volontairement à côté du sens évident de la déclaration de l’internaute qu’il identifie à un « jeune érudit » aux « prétentions peu ordinaires ». Le lecteur en question, qui a signé son message, Ivon Balès, figure familière des activités occitanes en limousin (voir ses blogs), qui n’est pas un tout jeune homme (sans vouloir le vexer) et qui ne se pose certes pas en « érudit », voulait évidemment parler de conscience linguistique. Il pense que l’autodénigration inhérente au terme de patois est le fossoyeur de la langue, et qu’il vaut mieux des locuteurs en petit nombre ayant conscience de parler occitan que des locuteurs en plus grand nombre qui considèrent que ce qu’ils parlent est et reste du « patois ». Pour ma part je ne suis pas d’accord avec cette manière de poser les choses (Balès se voulait juste, je crois, un tantinet provocateur), car l’inexorable extinction des locuteurs qui nomment ce qu'ils parlent « patois » est une catastrophe pour la langue, mais Mourguet sait bien que, pour autant, son contradicteur n’opposait pas deux langues distinctes, dont l’une (l’occitan) mépriserait et chercherait à écraser l’autre. C’est pourquoi sa conclusion, en « patois » (la préface est sinon toute en français), à mon humble avis, tombe à plat ; soit, dans sa graphie : « Leidoun io mè dissei : « moun viei, avéqué quèlès édéïès qu’est sègur què n’i auro pus dègu què parloro lu Limousi, un’ jour o l’autrè ». (N’i èn o què nè sè prénèn pas per n’importo qui !). Mè tabè ! » (p. 16). On aurait au contraire de bonnes raisons de dire exactement la même chose au sujet de sa propre perception obstinée de la langue comme patois : n’est-elle pas une justification de l’abandon de langue ? Cela, même s’il faut reconnaître qu’elle n’en est certainement pas un élément décisif, car l’usage du mot « patois », chargé de tout son contenu négatif dépréciatif, existait depuis le début de l’époque moderne. Enfin, que Mourguet le veuille ou non, c’est le syntagme « langue régionale » et non « patois » qui est reconnu par la plupart de ceux qui défendent ces idiomes et désormais par les élus. Personne ne pourrait en effet imaginer que les députés et les sénateurs réunis en congrès aient pu décider à la majorité de mentionner dans la constitution que « les patois font partie du patrimoine de la nation », c’est bien d’eux pourtant qu’il s’agit, mais sous une dénomination qui leur confère une véritable dignité linguistique, sans laquelle la question de leur reconnaissance et de leur défense ne se poserait même pas.
Jean-Pierre Cavaillé

une illustration de l'ouvrage de F. Mourguet
[1] Vive le patois limousin !... t. 3, La Veytizou, 2008 (et non 2003 comme indiqué p. 6).
[2] Par exemple cette réflexion au parfum de préférence française : « Io nè sabè pas per qui votar quand auvè dirè què lo Franço o bèsoué dè cinq cènt milo travaïlladous nouveux déinan et què per quo lo bèsoué dè far rèntrar cinq cènt milo immigras », p. 302.
[3] Soit, p 350, ce texte étonnant, que je reproduis pour son curieux millénarisme et qui montre en tout cas que Mourguet croit pouvoir confier au patois des pensées qui sans nul doute lui importent fort :
Tuèr lo cliardo.
Voulian tuèr lo cliardo què flambètaivo din’ mè,
Mâ nè pouguérèn pas d’èn leurs éteignadours
Lo far s’èn n’anèr coumplètaidamèn…
Au pus mau dè mo vito, l’ério bién toujours qui,
Mémo si lo n’ério pus qu’un’ rousi.
Lous quaus voulian lo tuèr ?
Quis què nè creuriè pè…
Mâ quo pourrio essèr tè, quo pourrio essèr mè.
Dègu n’est (n’éï) boun, noma lu Boun DI.
Maï si daus cops un’ sè damando èntè Au sè traubo.
Tout paisso èn queu moundè.
N’io daus méchants jours, n’io daus bouns jours.
Faut bè viaurè lous un’s, maï lous autrés,
Èn attèndant lu grand jour dè chaicun’.
Quis jours sè coumptèn per miliouns,
Chaiquè jour sur notro térro.
DI est trop grand per l’hommè,
Què nè pourro jamaï coumptar tous lous souleis.
Qui est quo (tchiéquo) dounc què l’hommè,
Per què lu Boun Di sè souvènguéssio dès è ?
Quand tornoro-t-eu per lu grand jour “total” ?
Quantè pus dègu nè puroro,
Pus dègu nè foro dè mau.
Et tous nous chantaram, nous dansaram,
Sur quèlo nuvélo Térro sé chabassi
Dè térro, d’ar, dè tèm, d’amour,
Èntè nous pourram trouvar lu Boun DI. », p. 350.
[4] Il raconte pour se conforter la petite histoire au sujet d’un éducateur qui l’a aidé à maîtriser la technique du traitement de texte : « No vè qu’au visaivo moun prumier librè, au dissei : « Tèto dè io bulli », èn comprènian dè seican. Mè dissei què lo méthodo phonétiquo per apprèner à parlèr lu patouei limousi ério lo bouno » (« Une fois qu’il regardait mon premier livre, il s’écria : « Tête d’œuf bouilli », en comprenant sur le tas. Je me dis que la méthode phonétique pour apprendre à parler le patois limousin était la bonne », p.264-5). La « méthodo phonétiquo », comme ces mots mêmes le montrent bien, n’a rien de phonétique, elle consiste à tenter de rester au plus près du français, et cela ne permet nullement de parler, mais d’écrire et de lire ; pour parler, il faut entendre parler, et l’on ne saurait bien sûr entendre parler le limousin à partir du français. S’agissant de lire, il est évident que la graphie classique est plus ouverte qu’une transcription en français patoisé, et d’abord, parce qu’elle permet indiscutablement à une nombre de lecteurs potentiels beaucoup plus importants (francophones et non-francophones) de « comprendre sur le tas », pour reprendre l’expression de F. Mourguet.
[5] Maurice Robert vient de faire paraître Les mots limousins du village : manières de faire, biais de parlar : histoire, patrimoine, traditions, Volume second , L-Z, Pageas, Société d'ethnographie et de sauvegarde des patrimoines en Limousin, 2008.



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F92%2F115864%2F129054934_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F17%2F115864%2F123220527_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F11%2F115864%2F104040903_o.jpeg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F46%2F51%2F115864%2F103970826_o.jpeg)