Béarnais, gascon, occitan : la guerre des noms et des graphies
L’écrivain Sergi Javaloyès m’a demandé de lui faire une petite préface pour l’essai bilingue qu’il va publier incessamment (si ce n’est déjà fait !) : Au nom de lenga. Au nom de la langue, Reclams, 2015. J’espère que ces lignes vous donneront envie de vous le procurer.
Béarnais, gascon, occitan : la guerre des noms et des graphies
Dans cet essai informé, réfléchi et pondéré sur le sujet on ne peut plus polémique de la façon de nommer et d’écrire la langue historique du Béarn et, au-delà, de l’ensemble de la Gascogne, l’écrivain Sergi Javaloyès pose deux questions essentielles, qui excèdent de loin la seule situation béarnaise et gasconne[1].
La première concerne la relation entre le nom que l’on donne à une langue – et d’abord le fait qu’on la nomme langue ou non – et sa pratique, c’est-à-dire sa vie, car la vie d’une langue est toute dans sa pratique et dans ses usages.
On s’accordera aisément à reconnaître que la pratique linguistique première, majeure et décisive est celle de l’oralité. Une langue vivante est d’abord une langue parlée. Aucun linguiste, quelle que soit son obédience, ne saurait en effet souscrire à l’ineptie de ces définitions confusionnistes qui font de l’existence d’une littérature le critère d’identification d’une « vraie » langue. L’écriture est bien sûr seconde et une langue n’est pas moins langue qu’une autre parce qu’elle n’est pas écrite, parce qu’elle n’a pas de littérature au sens strict (on parle certes de littérature orale mais ce concept est, littéralement, oxymorique). Tel n’est certes pas le cas de ce que l’on nomme béarnais, gascon, occitan (ces mots entretenant, selon qui les prononce, des relations d’inclusion et d’exclusion, voir infra), qui s’écrit depuis le Moyen-âge et possède une belle littérature. Mais il ne faut jamais oublier que la plus grande partie des langues parlées aujourd’hui encore dans le monde ne sont pas écrites par leurs locuteurs, et que ce fut aussi le cas de la totalité des langues humaines avant l’invention de l’écriture.
Ainsi naît une autre question et un étonnement légitime : pourquoi la plupart des querelles autour des langues sans État, dans les cultures où règne l’écriture, se polarisent-elles si souvent sur des questions de graphie ? Cela est encore plus aigu pour les langues historiques de France, et tout particulièrement pour ce que j’appelle l’occitan (voir infra), dans toutes ses variantes : alors que la langue parlée est dans la situation la plus critique qui soit, pourquoi faire de la graphie une question de vie ou de mort ? Ce qui revient à se demander – et c’est là justement la deuxième question que pose Javaloyès dans son essai –, ce que cache la graphie, de quoi l’obsession graphique est-elle le signe ou le symptôme ?
Envisageons d’abord le conflit des noms qui repose sur une conception foncièrement cratyliste selon laquelle le nom exprimerait l’essence d’une réalité, elle-même une et identique dans la durée, une identité essentielle que le nom révèlerait et contiendrait. Le fétichisme et l’essentialisme du nom sont inséparables du mythe de l’origine, selon lequel depuis « toujours », le nom a nommé une chose elle-même immuable, derrière ses apparences changeantes. Inversement, un nom manquant d’ancienneté trahirait la nouveauté de la chose, qui ne commencerait à exister qu’au moment où le nom apparaîtrait, mais il s’agirait alors d’un aveu de moindre existence, voire d’inexistence pure et simple de la chose, puisque pour cette représentation platonicienne des noms et des choses, n’existe que ce qui a toujours été et toujours sera.
Ainsi oppose-t-on le nom de « béarnais », associé – souvent du bout des lèvres – à celui de gascon, qui dirait la langue dans sa vérité et pureté originelle, au nom, honni par les béarnistes, « d’occitan ». L’occitan, comme ce nom seul suffirait à le prouver, désignerait une « autre » langue, venue du dehors – du Languedoc voisin – artificielle et récente, et cherchant à se substituer au béarnais. L’occitan est un étranger, un imposteur venant chasser le béarnais de son propre lit. Le problème, en Béarn – mais le même schéma se reproduit dans presque tous les lieux où il se trouve des locuteurs pour utiliser le mot d’occitan – c’est que le béarniste et l’occitaniste du Béarn parlent bien la même langue, du moins à l’oreille cela ne fait-il nulle différence. Mais dans les têtes, c’est autre chose !
Qu’il s’agisse de la même langue, est en tout cas ce qu’affirme l’occitaniste du Béarn et d’ailleurs, car le béarniste invoque généralement, comme preuve qu’il n’en est rien, la graphie dite classique de l’occitan, entièrement différente de la sienne, mise au point par l’Escole Gastoû Febus, reposant sur le code d’écriture phonétique du français (Javaloyès retrace avec précision cette histoire des graphies du béarnais dans son essai). La graphie classique de l’occitan est une modernisation et une rationalisation de la graphie médiévale des troubadours qui s’adapte aux différences dialectales et sous-dialectales. Les dialectes et sous-dialectes, parmi lesquelles le gascon et donc le béarnais, sous dialecte peu et mal défini du gascon[2], constituent en effet, pour les occitans, la langue occitane.
Affirmer que la langue n’est pas la même parce que la graphie diffère est évidemment irrecevable si l’on prend comme référence la langue parlée, qui fait loi. Il est par contre légitime de critiquer cette graphie, d’affirmer qu’elle est mauvaise, moins bien adaptée à son objet que la graphie à la française, ou qu’elle est plus malaisée à enseigner, etc. À condition, bien sûr, d’en produire la démonstration…
Je reviendrai sur cette obsession graphique qui est en fait partagée par les deux partis, et il faudra essayer de comprendre pourquoi. Pour l’instant, je me contenterai de souligner qu’en l’occurrence, le fond de l’affaire (mais il se pourrait qu’il s’agisse d’un double fond !) est l’affirmation par les béarnistes, que leur langue est différente des autres « langues d’oc ». C’est le pluriel qui importe ici, là où les occitans parlent au singulier, mais un singulier (une langue, l’occitan) qui enferme une pluralité (des dialectes occitans). Pour les béarnistes, leur langue – étendue non sans réticence à l’ensemble gascon – serait une langue à part entière, à côté des autres langues d’oc : le provençal, le languedocien, le limousin, l’auvergnat…
Chacune de ses langues possèderait son nom naturel, c’est-à-dire celui du territoire où elle est parlée, et l’occitan n’existerait donc pas. Le nom exprimerait le lien intrinsèque unissant la langue et le territoire. Comme l’Occitanie est un territoire non appelé ainsi par la plus grande majorité de ses habitants, un territoire qui n’a aucune existence juridico-politique, parler d’occitan n’aurait aucun sens. Par contre, l’invocation d’un nom de territoire, surtout s’il est établi de longue date, s’il dénomme ce qui a pu être une entité politique, comme celui de Béarn, suffit à légitimer l’idée qu’il existerait une langue consubstantielle à ce territoire. Javaloyès montre combien la promotion par le Félibrige des notions de « terre » (une « terre » qui parle vrai et dont le nom dit la « vérité »), de « pays » et de « petite patrie » a pu influer sur ceux qui, aujourd’hui chargent l’occitan de tous les maux, le percevant comme une langue métisse, impure et étrangère.
Or, il va de soi que ces représentations, si importantes pour la sociolinguistique, n’ont aucune pertinence linguistique. Elles montrent par contre, au-delà de la rhétorique du sang, de la souche, des racines et du terroir, combien les découpages et dénominations territoriales, jusqu’à celles des départements, pourtant créés pour détruire les découpages régionaux plus anciens et jusqu’à toute idée d’identité politique et culturelle des territoires régionaux ainsi émiettés sous l’autorité directe de l’État par ses préfets, influent sur la dénomination et même la perception que les populations se font de leur langue : ainsi entendrons-nous « langue limousine », « limousin », ou patois (au singulier !) du Limousin, ou même patois de la Haute-Vienne, voire patois du canton de Nantiat ou du canton de Bellac. Une fois le département aboli, pourra-t-on encore parler du patois du Tarn ou de l’Ariège ? Certainement, du moins autant de temps que ces mots renverront dans les représentations à des unités territoriales de référence, fussent-elles abolies.
L’occitan, lui ne peut se revendiquer que d’un territoire virtuel, l’Occitanie, qu’aucune institution politique ne reconnaît. Si l’Occitanie venait à exister un jour, il deviendrait évidemment « normal », « naturel », de parler d’occitan, autant que de parler de français (comme on le faisait bien avant que la langue ne soit unifiée), et pourtant cela ne ferait aucunement de l’unité du territoire un critère linguistique pertinent de l’unité de la langue ! Les arguments décisifs pour considérer que tous les parlers d’oc forment une seule langue – quel nom qu’on lui donne (mais il n’en existe pas d’autre sur le marché, hormis Langue d’oc, trop facile à confondre avec languedocien) – ne manquent pas. Le critère décisif, pour moi, est l’intercompréhension spontanée, retenue souvent comme critère majeur, et pourtant fragile (puisque soumis à la subjectivité des locuteurs) de la définition d’une langue. Or, celle-ci est indéniable et chacun peut en faire l’expérience.
Lorsque, venant d’Albi et de Toulouse, je suis arrivé en Limousin il y a une dizaine d’année, d’entrée de jeu, les différences phonétiques, lexicales et syntaxiques considérables ne m’ont pas empêché de comprendre immédiatement la quasi totalité de ce qui se disait. A l’Estivada de Rodez, dans les manifs unitaires ou au téléphone, les échanges avec les Gascons, les Provençaux, les Auvergnats et même (bien que moins aisément) avec les Catalans[3] sont spontanés, chacun parlant en son idiome propre … Il y a deux semaines, à Nantiat, dans le Nord Limousin, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière linguistique avec le pays marchois, alors que je présentais un film documentaire tourné dans la langue du cru, un ancien marchand de bestiaux prit la parole pour raconter ses expériences linguistiques : partout, raconta-t-il, dans les régions du « sud », « jusqu’aux Pyrénées » ; pour attirer la sympathie et par plaisir, il avait sa vie durant, selon ses propres termes, « patoisé » et s’était toujours fait comprendre. Cette intercompréhension spontanée, qui repose évidemment sur un fort ensemble de traits morphologiques, syntaxiques et phonologiques communs, à elle seule, est tout de même un critère sérieux pour considérer que nous avons affaire à ce que l’on peut appeler une langue, certes irréductiblement et complètement contenue dans ses différenciations dialectales et sous-dialectales. C’est du reste ce dont conviennent aujourd’hui la plus grande part des linguistes.
Mais sur ces questions, il n’y a pas, il ne saurait y avoir de consensus, car les considérations linguistiques sont toujours prises dans des engagements idéologiques, d’autant plus violents qu’ils ne s’énoncent pas directement.
Ces engagements concernent d’abord, mais certes pas seulement, ce que l’on veut faire de la langue. Si je me reconnais dans le nom d’occitan, c’est que je pense que ce que j’appelle ainsi mérite un avenir, vaut la peine d’être transmis et promu par tous les moyens : l’école, les médias, la famille aussi bien sûr. Si je dis occitan, c’est aussi que je tiens à l’enrichissement mutuel de tous ses dialectes constitutifs, par leurs confrontations et leurs rencontres et non par leur séparation. Je le dis d’ailleurs d’emblée, les seuls – mais immenses – intérêts que je vois à la graphie dite classique est qu’elle est un moyen de communication interdialectale, un moyen d’échange panoccitan, et qu’elle est aussi un outil d’enseignement efficace, à la fois du dialecte parlé autour de soi et de tous les autres. Dire occitan, c’est donc exprimer une forte curiosité pour l’ensemble des parlers d’oc, qui ne préjuge en rien de l’intérêt et de l’amour que l’on peut avoir pour le sien propre. Dire occitan, c’est aussi donner une chance d’avenir aux parlers qui le constituent, affirmer l’existence d’un patrimoine linguistique commun, riche, varié et possédant une dignité linguistique à part entière.
Car ce n’est pas un hasard, me semble-t-il, si l’on oppose toujours à l’unité et à la noblesse auto-revendiquées de l’occitan, considérées comme artificielle, fallacieuse et pleine de ridicule et vaine arrogance, la multitude, disparité et modestie (et bien souvent l’insignifiance) des « patois ». La négation de l’existence de l’occitan se fait en effet toujours ou presque au nom des patois, aujourd’hui encore. J’en ai glané quelques exemples récents sur internet, que chacun pourra retrouver : que l’on en juge ! « L’occitan est une invention née après la Seconde Guerre mondiale pour tenter d’unifier les nombreux patois locaux parlés dans le Sud de la France. Mais c’est une sorte d’espéranto qui ne repose sur aucune base linguistique avérée. En fait, l’occitan n’existe pas ! » ; « Je considère que l’occitan est une invention du XIXe siècle, tentative pour fédérer une myriade de patois locaux sous une bannière de droite conservatrice » ; « l'occitan est une invention récente de la mitterrandie, une sorte d’agrégat des patois de la Charente à la Provence » ; « L’occitan n'a jamais existé. C’est une création moderne, une sorte de pot-pourri des patois du Sud-Ouest » ; « Non, l’occitan n'a jamais existé sous la forme unifiée que veulent nous imposer les occitanistes. Il n’a jamais existé qu’une mosaïque de patois oraux servant à une communication de base au sein de communautés restreintes »[4].
Toutes ces déclaration disent quasiment la même chose dans les mêmes mots : il n’existe que des micro-parlers ultra-localisés et purement oraux (toute existence d’une littérature millénaire se trouve ainsi par la même occasion niée), qui ne sauraient, d’aucune façon, faire langue. C’est évidemment qu’ils sont d’abord victimes d’une représentation typiquement française de la langue, selon laquelle on ne peut vraiment parler de langue que si elle est unifiée et standardisée de longue date sous le contrôle d’institutions nationales. L’occitan n’existerait pas, car il serait une fabrication récente (dans une temporalité qui court du XIXe siècle à la « Mitterandie » d’après 1981 !), un esperanto que personne ne parlerait en dehors des occitanistes. C’est aussi ce qu’affirment tous ceux qui, comme les béarnistes, disent que les patois forment naturellement non une langue, mais des langues distinctes en des territoires séparés. Ainsi existe-t-il une alliance objective et profonde entre ceux qui soutiennent qu’il n’y a rien d’autre qu’une myriade de patois locaux et les tenants des langues d’oc, qui généralement d’ailleurs trouvent entièrement légitime l’usage populaire du terme de patois, alors que la plupart des occitanistes voient dans ce terme la marque de la plus grande aliénation linguistique.
Pour ma part, et je ne suis pas isolé, je suis beaucoup plus mesuré car il n’y a aucune raison de déligitimer la manière dont les locuteurs nomment ce qu’ils parlent, parce que, justement ils le parlent en quelque sorte avec et même dans ce nom qu’ils lui donnent. Il est donc normal de parler de patois avec les locuteurs qui utilisent le terme, souvent sans aucune dépréciation, du moins consciente d’elle-même. Par contre il va de soi que désigner la langue par ce mot dans les relations avec le public et les autorités revient ipso facto à ôter toute légitimité à un aide publique et à toute forme d’enseignement (« le patois ne s’apprend pas, il se sait ! »). Je note d’ailleurs que les mouvements anti-occitanistes convergent pour la plupart dans une position vis-à-vis de l’enseignement scolaire, qui oscille entre le scepticisme et la franche hostilité[5]. Javaloyès, vice président de la confédération des écoles Calandretas en sait quelque chose et ce n’est pas seulement ce système particulier qu’ils rejettent – associatif et laïque sous contrat – mais implicitement toute autre forme de transmission conséquente de la langue aux enfants, puisqu’ils ne proposent aucune alternative. Or, pour ma part, je constate que seul l’enseignement par immersion – outre évidemment la transmission directe familiale ou de voisinage – est susceptible de créer des locuteurs qui, certes, s’étiolent vite lorsqu’ils sont soustraits de toute pratique hors de l’espace scolaire. Pourtant, l’occitan est accusé – il faut bien un bouc émissaire, lorsqu’on estime que la grande patrie ne saurait d’aucune façon avoir contribué à diminuer les petites – d’être l’assassin et le fossoyeur de la langue parlée, parce qu’il trahirait celle-ci en lui imposant un mode de transmission illégitime (l’école) et surtout les atteintes atroces d’une graphie barbare, hispanisante (dit-on !), mauresque, apatride qui aliènerait à tous jamais la langue maternelle, la langue de la terre, du pays et du sang.
Car, nous l’avons déjà dit, la preuve du mensonge occitan, la preuve de son imposture, du fait qu’il serait autre chose que ce qui est véritablement parlé par les locuteurs (l’idée que l’occitan se construirait en dehors des patois et contre eux a largement pénétré les esprits), résiderait, comme on l’a dit, dans l’usage d’une graphie commune à l’ensemble occitan, qui ne change pourtant nullement les façons de parler, puisqu’elle est au contraire sensée s’adapter à une diversité intrinsèque et irréductible.
Il nous faut donc revenir sur cette question, mais en précisant que le rejet de la graphie classique, à laquelle il est reproché, entre autres choses, son archaïsme médiévalisant, est inséparable de la dénonciation du déficit d’ancienneté et du nom et donc, selon le paralogisme déjà décrit, de la chose elle-même. L’occitan dissimulerait ainsi sa nouveauté derrière une fausse apparence d’antiquité.
Or il est évident que l’occitanisme lui-même tombe largement dans le piège de l’origine. Il est à la recherche de la reconnaissance et de la légitimité niée de l’occitan à travers les démonstrations récurrentes d’un être et d’une unité pérennes et originaires. Comment pourrait-il d’ailleurs en aller autrement, sur ce terrain, où seul celui qui rend crédible sa participation mythique à l’origine est légitime ? Ainsi de la supposition erronée, reposant sur l’existence de la koinè écrite des troubadours, d’une langue unique médiévale qui se serait diversifiée au fils des temps du fait de la perte d’autonomie culturelle et politique (ce qui est une grossièreté historique et linguistique). Ainsi des efforts pathétiques pour démontrer que le nom présente lui-même tous les caractères d’antiquité (Occitania, Occitanus, occitanica, etc.), avec bien sûr une référence obligée et appuyée aux troubadours. Et il va de soi que l’adoption de la graphie classique, en effet délibérément archaïsante et étymologisante, est étroitement liée à cette quête de légitimité par l’origine et l’antiquité. Le fait qu’elle soit indiscutablement plus simple et plus rationnelle que la graphie calquée sur le français, et qu’elle soit facile à enseigner et à acquérir, n’y change rien.
Ici, il me semble pour ma part qu’il ne faut pas traiter à la légère l’injonction des félibres gascons « d’ana au pòble », reprise par certains membres de l’Escola Gaston Fébus contre la graphie classique (« un soul tesic : ana au pòble e ha-s coumpréne d’et », André Serrail), pour justifier l’option d’une graphie fondée sur le français. On peut toujours, et l’on doit se demander, comme le fait Javaloyès, qui est ce peuple anonyme et, par définition, muet, vers lequel il faut aller, pour l’éclairer de ses lumièred et lui faire lire, sinon écrire, sa propre langue ? Mais il n’en demeure pas moins, que la question de l’accès immédiat au code de lecture, pour des locuteurs dont la seule langue écrite est le français, se posait et se pose en fait toujours, dès lors que l’école de la République se refuse à enseigner aux enfants (exception faite des rares classes òc-bi et cours d’initiation tardifs) les rudiments du code alternatif, à mon sens en effet plus cohérent, proposé par la graphie classique. Quel crève-cœur d’entendre prononcer rigoureusement à la française les panneaux bilingues ou le mot calandreta, parfois de la bouche même des parents de calandrons, ou celui d’occitan, ou d’Occitania ! C’est pourquoi je comprends la tentation d’opter pour des graphies à la française, aisément accessibles et utilisées spontanément par les gens pour baptiser leurs maisons, vanter des spécialités culinaires et autres produits marchands. Je trouve en outre tout à fait légitime de republier les textes écrits dans des graphies basées sur le code français sans les traduire systématiquement en graphie classique, ne serait-ce que par respects pour les personnes qui les ont lues dans leur jeunesse sous cette forme.
Pourtant je suis convaincu qu’il faut continuer à promouvoir la graphie classique qui, je l’ai dit, présente le mérite insigne de se plier aux différences dialectales, et s’est de toute façon largement imposé dans le monde de l’enseignement, de la recherche, des médias occitanes (ils sont rares, mais il y en a !) ; de sorte qu’elle s’impose naturellement à moi, dès lors que je recherche la communication la plus large possible. Ceux qui la critiquent tant ne trouvent rien à redire au français, qu’ils prennent comme base de leur graphie, alors qu’il souffre de l’une des pires orthographes du monde ! Mais c’est que s’agissant de la langue nationale encadrée par l’Académie la question de la légitimité de la graphie française ne se pose pas ; elle est imposée par le haut à tous, et ceux que le médiévalisme de la graphie occitane classique hérisse, bichonnent sans sourciller d’absurdes accents circonflexes à valeur purement étymologiques (ci git un « s » !), et un tas d’autres idioties graphiques que j’applique, parce que l’on ne saurait se soustraire aux règles communes de la communication écrites sans renoncer à la communication elle-même. C’est pour la même raison que j’utilise, sans état d’âme, la graphie alibertine quand j’écris en occitan. Son intérêt majeur est qu’elle permet la communication écrite interdialectale : grâce à elle, il existe une littérature, une presse papier, des journaux et blogs en ligne à la fois dialectale et panoccitane.
On pourrait, on devrait évidemment penser que la graphie n’étant qu’une façon d’écrire et non de parler, est, comme on l’a dit en commençant, une question tout à fait secondaire par rapport à l’urgence absolue de transmettre la langue parlée. On pourrait se dire « la graphie, aquò rai ! » : rien de plus facile que de reconnaître également deux systèmes, comme le font les jurys d’examens et de concours d’enseignement autorisant à composer en graphie classique et en graphie mistralienne. Il en va de même pour le nom : ils peuvent aisément s’articuler : rien n’est plus courant ici d’entendre dire, sans problème majeur (nous n’avons pas de limousinistes !), langue limousine, occitan limousin, occitan et même patois limousin ; rien n’est plus simple que de marteler que ces mots désignent la même réalité linguistique, même si l’on préfère pour de bonnes ou mauvaise raisons l’une ou l’autre de ces appellations.
Mais il n’en va pas ainsi, car la graphie est toujours plus qu’elle-même, elle est toujours associée, non certes par essence, la non plus (à la façon des idiots qui disent que la graphie alibertine est fasciste puisque Alibert s’est compromis pendant la guerre – mais que faisait à la même époque les membres de l’Académie française ?), mais conjoncturellement à des représentations de la langue, à des façons de la concevoir, de l’identifier, en relation avec des valeurs. La graphie est toujours le vecteur d’idéologies linguistiques et politiques en même temps. C’est le cas même lorsqu’on ne la discute qu’à l’extrême marge, comme pour le français (enlever les circonflexes, pour certains revient à martyriser, tuer le français !). Cela est beaucoup plus évident lorsqu’il y a concurrence et conflit des graphies. Javaloyès, dans son essai, montre ainsi les enjeux du conflit, non seulement concernant les représentations de la langue, de son statut, de son passé et de son avenir, mais aussi des valeurs qui lui sont immanquablement associées, car une langue ne saurait être un simple instrument, un simple outil technique de communication ; elle engage nécessairement l’ensemble des règles et des valeurs sociales dans lesquelles se reconnaissent les locuteurs et qui ne font jamais l’objet d’un consensus, mais sont toujours en discussion. Au lecteur de se retrouver plutôt dans les valeurs promues par les béarnistes ou dans celles défendues par les occitanistes.
Il est une question cependant que Javaloyès ne fait qu’effleurer et que nous ne pouvons évidemment instruire ici : elle est celle des raisons pour lesquelles la résistance à l’occitan en Béarn est si forte. Ces raisons me semblent relever de l’histoire politique et culturelle du Béarn, ou plutôt de la représentation multiséculaire que s’en font de nombreux habitants de la région : elles tiennent à la très forte conscience historique de l’identité béarnaise en particulier et gasconne en général, appréhendée dans une relation intrinsèque immédiate, sans médiation aucune, avec l’identité française. Il faudrait ici convoquer l’histoire du règne de Navarre, qui a fourni à la France un roi et une dynastie qui ont introduit l’absolutisme et le centralisme. Il faudrait aussi évoquer le mythe et la réalité des cadets de Gascogne versant leur sang pour les rois de France, faisant fortune ou rencontrant l’infortune à la ville et à la cour, c’est-à-dire au lieu même du pouvoir central. Il faudrait enfin décrire et analyser l’exaltation récurrente, inséparable de cette représentation guerrière et royale, du gascon « des montagnes » dont Montaigne est l’un des premiers artisans : un langage « beau, sec, bref, signifiant, et à la verité un langage masle et militaire, plus qu'aucun autre », parmi une multitude d’autres « langages » du sud du royaume, « brodes » (efféminés), « traînants » et « esfoirés »[6]. Ainsi, l’articulation de la petite patrie à la grande est-elle spontanément appréhendée comme une espèce d’union mystique entre le Béarn et la nation française, monarchique ou républicaine, qu’aucune altérité ne saurait venir troubler. L’occitan vient rompre cette union sacrée, ce lien consubstantiel. Il s’interpose entre la petite et la grande patrie ; aussi est-il perçu comme l’instrument à la fois du parti de l’étranger et de l’ennemi intérieur.
Tout cela n’est, une fois encore, qu’une question de nom, mais le nom est et sera toujours le vecteur de toutes les dissensions et de tous les conflits. Heureusement que les mots et les noms ne cessent de changer de sens, tout comme les configurations culturelles et sociales auxquelles ils appartiennent et dont ils sont les étendards. A nous de les transformer.
Jean-Pierre Cavaillé
[1] Javaloyès a reçu le prix Joan Bodon pour son roman L’Ora de partir, en 1998 et le prix Jaufre Rudèl pour Tranga & Tempèstas en 2006. Outre une œuvre romanesque, il a aussi à son actif de la poésie (par exemple son épopée du gave de Pau Sarrom Borrom) et des essais.
[2] « On voit par exemple qu'on oppose traditionnellement béarnais et gascon, alors que celui-ci n'est qu'un sous-dialecte, assez mal caractérisé, de celui-ci. Il est évident que c'est le cadre historico-géographique du Béarn qui a imposé cette vision erronée des faits », Pierre Bec dans La langue occitane, Paris, P.U.F., p. 33-34, n. 1.
[3] Évidamment, cette intercompréhension avec le catalan met en cause la légitimité de la séparation de l’occitan et du catalan, comme s’il s’agissait de deux langues entièrement distinctes et du même coup met en évidence une limite de la notion même d’occitan.
[4] Respectivement, André Joly cité sur le site de l’IBG ; internaute signant Boralion (site Dépêche du Midi, 9/11/2014) ; autre internaute signant Conophobe (site Dépêche du Midi, 16/06/2011) ; Geneviève Monteilhet (de Garlin, 64, site Sud-Ouest, 04/02/2012) ; internaute signant Jean Aimarre (site Dépêche du Midi, 24/10/2009). Les italiques sont de moi.
[5] Pour Jean Lafitte par exemple, l’apprentissage de la langue, limité à des chansons et à des textes, vient après et comme en complément de l’histoire régionale : « Pour le gascon d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, comme pour toutes les langues historiques des autres régions de France, le réalisme me conduit à préconiser avant tout un enseignement aussi vivant que possible de l’histoire du pays, en relation avec les lieux et les monuments ; il devrait être assorti d’une initiation à la langue par les chansons et l’étude de textes des diverses époques, et notamment, pour le gascon et sa variante béarnaise, des œuvres si belles que nous ont laissées les Félibres », « À l’école : enseigner les langues ou l’histoire des régions ? », blog de l’auteur pourtant intitulé : Autour du gascon. Lettres à mes élèves.
[6] Essais, II, 17, De la presumption.

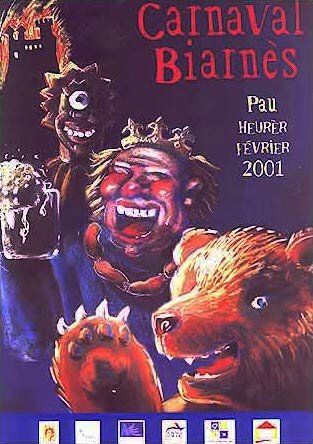


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F77%2F115864%2F127947034_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F11%2F115864%2F125629362_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F55%2F97%2F115864%2F125525639_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F98%2F115864%2F123537864_o.jpg)