Sur la notion de dialecte
La discussion en italien d’un article de Nicola De Blasi que j’ai publiée simultanément sur le site de l’Istituto Linguistico Campano et sur ce blog a donné lieu à une réponse de l’auteur, que l’on peut trouver sur le site napolitain. Amedeo Messina, qui dirige l’ILC, a pris prétexte de cette réponse pour élaborer une réflexion critique sur la notion de dialecte (publiée sur le même site), telle qu’elle est utilisée en Italie. Il m’a paru très intéressant de la traduire pour le public francophone, car une grande partie des apories mises en évidences par Messina rejoignent bien des arguments critiques que nous avançons, de ce côté des Alpes, pour contester la pertinence de la notion de patois. Néanmoins, comme on le verra vite, les deux notions, issues de traditions linguistiques et surtout socio-politiques bien différentes ne sauraient être confondues. Il faut même accepter de voir que l'argumentaire visant à montrer la légitimité de considérer le napolitain, ainsi que les autres "dialectes" italiens, comme des langues à part entière, appliqué à l'occitan, est susceptible d'en mettre l'unité linguistique en question. C'est pourquoi il est urgent de développer le comparatisme sur ce sujet.
Sur la notion de dialecte
Amedeo Messina
Dans sa très précieuse intervention, publiée sur notre site le 30 avril 2007, Nicola De Blasi entend avant tout préciser que par l'usage du mot de dialecte, on ne veut offenser aucun langage, ni d’aucune façon le mépriser ; le terme serait seulement un substantif nécessaire à la clarté descriptive des enquêtes scientifiques des linguistes. Autrement dit, il revendique pour les sciences la légitimité de choisir selon les occasions les termes et les notions qui définissent utilement l’objet sur lequel porte la recherche. Il ne me semble cependant pas que les jugements exprimés par Jean-Pierre Cavaillé sur l’article de De Blasi intitulé « Per la storia contemporanea del dialetto nella città di Napoli » (« Pour l’histoire contemporaine du dialecte de la ville de Naples »), publié en 2002 dans la revue spécialisée Lingua e stile, proviennent d’un sentiment de mépris, d’outrage vis à vis du napolitain, qui serait le plus souvent véhiculé dès lors qu’on le définirait comme dialecte, ainsi que De Blasi lui-même le perçoit en quelque façon dans le texte du collègue français. Il me semble important de préciser qu’une critique à propos du terme dialecte concerne l’usage qui en est fait comme notion prétendant à la scientificité, et non à propos de tel ou tel dialecte. L’analyse correcte du problème que nous voulons examiner maintenant, justement parce qu’il concerne les domaines de la terminologie et de l’épistémologie, est entièrement étrangère à ce que le professeur de linguistique italienne nomme « un préjugé anti-dialecte enraciné ». La question est tout à fait différente. Sommes-nous vraiment certains d’appeler les choses par leur propre nom ? Et sur quelles bases se légitime le pouvoir d’attribuer un nom aux instruments en usage en chacune des sciences ? Il ne vient à l’esprit de personne de crier au scandale s’il entend appeler dialecte un langage dialectal, mais il y a bien une raison de protester si quelqu’un persiste à confondre le palais et la chaumière, c’est-à-dire si l’on nomme dialecte ce qui souscrit à tous les réquisits pour être considéré comme une langue pure et simple.
Ce n’est certainement pas à moi à rappeler la règle d’or de Ferdinand de Saussure, selon laquelle ce père tutélaire de la linguistique enseigne qu’en cette science, à la différence de tant d’autres, l’une des principales difficultés consiste à comprendre comment c’est seulement « le point de vue qui crée l’objet ». Ou bien comme l’a rappelé par la suite Luis Jorge Prieto, la linguistique n’a pas pour objet propre la réalité matérielle, mais seulement « un mode de connaissance de la réalité matérielle » (Pertinenza e pratica, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 109). Cette dernière cependant, qu’elle soit dialecte ou langue, ne possède pas une consistance externe, neutre et objective, mais elle est le produit d’un choix du savant lui-même ou de la communauté scientifique à laquelle il se réfère. Celle-là même qui fait dire au sociolinguiste français Jean-Louis Calvet que l’opposition langue/dialecte est une fiction créée expressément par les linguistes pour couvrir d’un vernis scientifique leur « glottophagie » (Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, Paris, Payot, 1974; trad. it. di D. Canciani, Linguistica e colonialismo. Piccolo trattato di glottofagia, Milano, Mazzotta, 1977, p. 93).
Je ne pense pas du tout que De Blasi veuille dévorer ses « dialectes » en se réservant la joie de déguster le napolitain pour son dîner. Certainement, il a bien raison de rappeler que « le mot de dialecte est couramment utilisé dans les études linguistiques scientifiques », et c’est précisément cet usage qu’il convient d’interroger. La fréquence avec laquelle cette notion est utilisée ne conduit-elle pas à l’accepter trop facilement, alors même qu’elle s'éloigne des besoins de clarté nécessaires à la linguistique et aux langages collectifs ? De Blasi lui-même affirme que le critère du choix du terme dialecte est la réponse à l’exigence de clarté descriptive dans la science qu'il pratique. L’énoncé serait sans aucun doute juste, s’il y avait vraiment une pleine correspondance entre les notions, les analyses et les théories décrivant clairement leur objet, en l’occurrence le dialecte, et en définissant avec la plus grande évidence la majeure partie des phénomènes observables dans le champ de la recherche. Mais ici est arrivée à point une observation de Giovanni Alessio, tombé aujourd'hui dans l'oubli et qui fut pourtant un exceptionnel enseignant de glottologie à l'université de Napoles, selon laquelle « la différence entre langue et dialecte relève plus de la pratique que de la science » (« I dialetti della Calabria », in Almanacco Calabrese, XIV, n° 14, Istituto Grafico Tiberino, Roma, 1964, p. 17).
Tant il est vrai qu’en linguistique on chercherait en vain une claire description du dialecte ou alors, lorsqu’on en trouve une, elle ne remplit pas ses promesses. Il s’agit d’une notion endogène, propre au lexique des linguistes, et qui plus est différente selon les diverses communautés scientifiques, représentant pour eux-mêmes une croyance issue de la pratique scientifique immédiate et quotidienne, fruit autrement dit d’une épistémologie spontanée plus que d’une confrontation avec la réalité extérieure, immatérielle et abstraite. Si bien que, par honnêteté, De Blasi déclare, à propos des termes dialectes, langue et autres, qu’il s’agit de notions bien connues, appartenant « à une tradition scientifique éprouvée et partagée (de sorte que certains concepts n’ont pas à être répétés chaque fois que, dans une revue scientifique, on s’adresse à un public de spécialistes) ». Cela veut peut-être dire qu’en dehors de la communauté des linguistes notre excellent De Blasi pourrait s’exprimer différemment ? Que peut-être, devant un plus vaste public, dénué de toute compétence scientifique, il définirait comme langue ce qui pour les spécialistes doit être entendu comme dialecte ? Personnellement, je ne le crois pas. Et peut-on donc en déduire que son énoncé doive être interprété comme une exhortation destinée à ceux qui cultivent simplement la passion des langues de s’abstenir de toute intervention qui dérangeraient les linguistes ? Ce serait-là, en vérité, une vision tautégorique de l’œuvre scientifique, confinée aux cloisonnements disciplinaires et privée d’une quelconque utilité sociale.
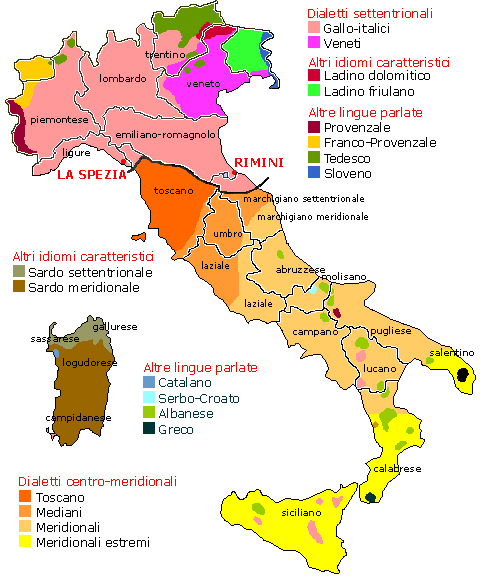
La mosaïque italienne : une taxinomie fort discutable
Il est bien vrai que l’usage invétéré parmi les linguistes, en général professeurs d’université, d’un lexique spécialisé qui leur est propre, n’est pas plus fortuit que ne l’est la plate acceptation des étudiants et des amateurs éclairés. Ce n’est pas un hasard si cette hégémonie de la culture universitaire réapparaît dans la langue populaire, pour laquelle le terme dialecte a seulement le sens de ce qui n’est pas « langue italienne », sans aucune référence au prestige, ni à la nationalité, mais seulement à une fonction communicative. La tradition partagée de ce lexique est le produit d’une auto-référentialité académique, qui n’est pas en mesure de comprendre la divergence entre la réalité tout à fait extérieure et l’autorité statutaire conférée à la parole des enseignants, qui en elle-même tend à exclure aussi bien le rapport entre production scientifique et les objets de la science que les retombées en terme d’information du plus grand nombre. Sans aucun doute, seule l’épistémologie peut décider des conditions théoriques d’une pratique scientifique voulant se définir comme rigoureuse ; toutefois la terminologie des pratiques linguistiques montre aisément combien est faible et arbitraire le dispositif lexical, et donc des notions et concepts utilisés et imposés par les experts des objets linguistiques. En politique, tout comme parmi les intellectuels, il n’y a rien de plus concret que les discussions sur les mots. Modifier une signification ou même utiliser un mot à la place d’un autre veut presque toujours dire changer la vision de la réalité qui nous entoure et que nous sommes nous-mêmes. Tant il est vrai que c’est là l’un des critères, peut-être le plus immédiat et répandu, pour qualifier comme dialectal un quelconque idiome différent du sien et que l’on considère comme « incorrect » dès qu’il s’éloigne de la variété territoriale avec laquelle on use du même modèle prestigieux de la langue nationale.
Cela voudrait peut-être dire que, par le terme de dialecte, chaque linguiste définit un objet spécifique de recherche, décrit avec la plus grande clarté possible. Mais il n’en va pas même ainsi. A l’origine, dialecte désignait un simple échange verbal, la simple conversation entre amis et familiers, le sermo unicuique genti peculiaris, dans la définition classique fournie par Robert Estienne dans son Thesaurus linguae latinae publié en 1532. En Italie, ce n’est qu’en 1724, sous la plume de l’abbé et académicien de la Crusca Anton Maria Salvini, que s’est imposé l’usage de doter le terme dialecte de la signification réductive de parler natif, originaire d’un territoire particulier. Salvini écrit en effet : « Vos dialectes natifs font de vous les citoyens de vos seules cités ; le dialecte toscan que vous avez appris, reçu, embrassé, fait de vous des citoyens de l’Italie »[1]. Choix donc, comme on peut le noter, imposé par une hégémonie d’abord culturelle et ensuite politique, qui n’a pas grand chose de scientifique, à moins de convenir que le dialecte serait un système linguistique capable de satisfaire seulement certains aspects des besoins expressifs, relevant du populaire et du quotidien, mais excluant la technique, les sciences ou la littérature et qui, par rapport à la langue officielle d’un État, se distingue par le lexique et les phonèmes propres, l’intonation, la morphologie et la syntaxe. Ce choix, en outre, avait au XVIIIe siècle un sens qui se retrouve aujourd’hui dans la volonté de se déclarer citoyen du monde entier, en s’opposant, en même temps, aux hégémonies globalisantes qui voudraient réunir et uniformiser les peuples et les nations. Ce dernier projet, comme on le sait bien, s’accompagne du cauchemar du globish, un angloamericain planétaire auquel s’oppose le retour aux langages régionaux menacés d’extinction.
Or une telle définition ne me semble guère satisfaire l’exigence de clarté descriptive revendiquée par De Blasi. Ce n’est pas un hasard, pour le dire avec les mots de Claude Hagège, professeur de linguistique au Collège de France, si « l’attribution à un idiome donné, de l’un ou l’autre de ces deux statuts [langue et dialecte] varie selon les linguistes, et tous ne s’accordent pas sur la définition qui paraît la plus simple : une langue est celui des dialectes en présence (à un moment donné) qu’une autorité politique établit, en même temps que son pouvoir, dans un certain lieu ». (Halte à la mort des langues, Paris, Jacob, 2000, p. 195). Il faut dire que cette thèse d’Hagège a bien des prédécesseurs et aujourd’hui ceux qui la partagent sont plus nombreux encore. Si elle ne suffisait pas à nous éclairer, on pourrait toujours demander leurs lumières aux vaillants lexicographes italiens, compulsant leurs dictionnaires à la recherche d’éléments capables d’éclairer tous ceux qui, moi compris, ne sont justement pas des spécialistes et croient cependant en un usage démocratique des sciences, outre le fait qu’ils nourrissent une très grande amitié pour leurs propres langues.
Qu’il me soit cependant permis de partir d’une confrontation avec certaines positions « étrangères », pour en venir ensuite à nos vicissitudes italiennes. Je tiendrai compte en premier lieu de la notion de dialecte telle que la propose les linguistes canadiens et états-uniens, par laquelle ils désignent toute variété géographique d’une langue. Par exemple, est un dialecte, selon eux, l’espagnol mexicain ou argentin, le français du Québec ou les diverses formes d’anglo-américains, tout comme nous Italiens nous pourrions dire que l’italien de la Romagne, ou bien celui parlé à Naples ou en Sardaigne, sont des dialectes. Les mêmes linguistes, mettant de côté la connotation géographique, nomment social dialect les langages populaires provenant des langues originaires comme le black-english des États-Unis et le cockney du sud-est de l’Angleterre. L’italien standard pourrait donc lui-même être considéré comme un dialecte de l’italien. En Europe, par contre, la majeure partie des linguistes interprètent le dialecte comme la notion des variétés produites dans un processus diachronique, diatopique et diastratique depuis une langue ancienne jusqu’aux langages contemporains. Dans ce cas, toutes les langues romanes sont des dialectes du latin, mais le latin lui-même, à son tour serait, à ce qu’on affirme, un dialecte du sous-groupe occidental du groupe italique de la famille indo-européenne.
Il existe enfin un quatrième sens au terme de dialecte. Il est utilisé en sociolinguistique pour désigner toute variété subordonnée à une langue standard dans une communauté linguistique déterminée. De sorte que tous les dialectes dont il est question dans les définitions précédentes peuvent en outre relever de cette quatrième catégorie, même s’il faut tenir compte du fait que tous les espaces linguistiques ne possèdent pas une langue standard. On aura maintenant compris que la polysémie du terme dialecte génère une grande confusion, au point de rendre son usage faible et arbitraire. A cela s’ajoute enfin les emplois qu’en font les linguistes italiens pour spécifier l’objet d’une nouvelle entreprise scientifique à laquelle ils donnent le nom de dialectologie. Une science inventée naguère qui se propose d’étudier tel ou tel dialecte néo-latin qui, dans la compétition dont le prix était le titre de langue nationale de l’Italie unifiée, n’a pas remporté la première place. Il s’agit, pourtant de systèmes linguistiques autonomes, complets du point de vue du lexique, de la phonétique et des formes syntaxiques, ayant une histoire originale déjà depuis les temps de la contamination avec les langues des Romains et qui se sont développés ensuite au contact des divers peuples ayant envahi au cours des siècles la péninsule italienne.
Les systèmes linguistiques italiens, ceux-là même que plus d’un linguiste persiste à étiqueter comme dialectes, s’opposent à la notion de dialecte précisément parce qu’ils ne possèdent pas de signes et de règles combinatoires de même origine que le système linguistique toscan devenu langue nationale. Autrement dit, le piémontais et le napolitain, le vénitien et les parlers des Pouilles, le romagnole et le sicilien, pour donner quelques exemples, ne sont pas né de l’évolution du florentin ni, à plus forte raison, de la contamination de l’italien. En outre, ce sont des langues régionales, ou minoritaires si vous voulez, par le simple motif qu’ils se différencient à leur tour pour leur propre compte. Il n’est personne qui n’entende ou ne lise, en fait, combien diffère la langue piémontaise et le dialecte d’Asti, la langue napolitaine et la variante de Pozzuoli, la langue vénitienne et la variante de Vérone, et ainsi de suite, pour ne rien dire de la grande variété entre le palermitain et le catanais en Sicile. Nous pourrions appeler de tels sous-systèmes d’une langue régionale des “dialectes”, mais seulement avec le sens donné à ce terme par les anglo-saxons, c’est-à-dire de variétés linguistiques, sans aucune connotation d’un autre type. Même les espagnols utilisent le terme de dialecto, ajoutant au sens de la variété celui de l’étroite dérivation, rejetant donc les connotations hégémoniques ou spatiales. Nombreux sont par ailleurs les linguistes qui appliquent le critère de non standardisation, avec le but de créer une ligne de séparation entre dialecte et langue, c’est-à-dire croyant que l’absence d’une réglementation normative suffit à connoter une réalité linguistique comme dialectale.
Un bon point de départ pour l’examen de la notion de dialecte dans la linguistique italienne est peut-être celui fourni par la notice que lui consacre Giulio Bertoni qui peut se lire dans la plus récente édition du volume XII de l’Enciclopedia italiana (Roma, Ist. Encicl. Italiana, 1931, p. 734). « La conception des dialectes comme autant de types linguistiques circonscrits dans certaines limites est justifiée par les besoins et la nécessité scientifiques ; et l’on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une conception fausse, parce que, rigoureusement parlant, il ne pourrait même pas avoir d’utilité, s’il ne contenait des éléments de vérité. Mais ces éléments résident en chacun des phénomènes considérés, et non pas dans la notion générale, qui veut tous les rassembler dans le même sac ». En d’autres termes, selon le philologue de Modène, ce que les linguistes entendent par la notion de dialecte sert seulement à détailler le parler typique d’une communauté déterminée en un espace circonscrit, mais jamais une langue, surtout si elle est parvenue à la production littéraire. A vouloir mettre dans un seul et même sac les divers dialectes d’une langue, la notion générale de dialecte, soit ce que j’appellerai par la suite l’essence substantielle de l’objet nommé, en lui subsumant jusqu’à certaines langues dont le nombre de locuteurs s’élève à plusieurs millions de personnes, devient inutilisable par les linguistes et incompréhensible aux profanes.
Dans le Grande dizionario della lingua italiana, inauguré sous la direction de Salvatore Battaglia, on peut lire à l’entrée dialecte : « Parler propre à un espace (ambiente) géographique et culturel restreint (comme la région, la province, la ville ou même le village) ; par opposition à un système linguistique proche par l’origine et le développement, mais qui, pour diverses raisons (politiques, littéraires, géographiques, etc.) ne s’est pas imposé comme langue littéraire et officielle » (Torino, U.T.-E.T., 1966). Définition, comme on peut le voir, d’une grande négligence. D’abord parce qu’elle oppose (?!) « système linguistique » à parler ou dialecte, comme si celui-ci n’étaient pas tout autant des systèmes linguistiques. En second lieu, parce qu’elle enferme chaque dialecte entre des barrières de réalités qui n’ont rien de linguistiques, en tant que simples expressions d’une volonté toute politique et administrative. La Campanie, par exemple, est une pure invention faite dans un bureau, qui ne comprend pas tous les locuteurs de la langue parténopéenne et qui recouvre par ailleurs des langages qui ont bien peu à voir avec le napolitain. En outre, il n’y a pas de ville qui n’ait son propre parler, parce que diverses variables interviennent entre quartiers, générations et classes sociales. Pour ne rien dire, enfin, des provinces fatidiques où, prise une à une, il paraît absolument impossible de mettre tous les parlers en un même sac.
On pourra dans ce cas hésiter entre deux positions différentes. Les uns soutiennent une définition d’ordre spatial, comme fait le Zingarelli, pour lequel le dialecte est un « système particulier utilisé en des zones géographiques limitées » (M. Dogliotti e L. Rosiello, Bologna, Zanichelli, 1994). Pour les autres se trouve subsumé dans la notion tout système linguistique présent en un espace géographique et culturel limité, qui n’a pas acquis ou qui a perdu une autonomie et un prestige, en relation à un autre « système devenu dominant et reconnu comme officiel, avec lequel cependant, et avec d’autres systèmes circonvoisins, il forme un groupe d’idiomes très voisins du fait de dériver d’une même langue mère » (A. Duro, Vocabolario della lingua italiana, Roma, Ist. Encicl. Italiana, 1987). La plus récente dialectologie italienne a cependant tenté d’échapper aux unités compactes présupposées des dialectes, en quelque façon opposées en sous-variétés au systèmes dialectal dominant. Elle a voulu prendre acte des apories de la méthode d’analyse habituelle dans les sciences naturelles, mais tout à fait trompeuse dans l’étude des langues, en développant des recherches sur les multiples variétés des répertoires linguistiques et des phénomènes qui les caractérisent. Sauf qu’à la base des procédures innovantes demeure le présupposé idéologique d’un État ou d’une nation dans laquelle toute la production linguistique des citoyens locuteurs est obligée à se refléter. Instrument archaïque, obsolète, en voie de disparition rapide, en des temps où s’affirment les droits personnels au particulier et à l’universel, autrement dit à une tradition propre en même temps qu’à l’ouverture au monde entier ou, pour le dire en d’autres termes, à l’identité et à la différence où chacun et tous sont des citoyens du village planétaire.
Je ne pense pas que l’on puisse imaginer une culture universelle et à plus forte raison une langue qui soit vraiment parlée sur l’ensemble de la terre. Tout ce qui actuellement passe pour global est seulement une expansion à la démesure d’une fausse vérité qui transforme le monde en valeur marchande. Je pense, par contre, que l’on se défend d’une semblable menace en renforçant, chacun à son niveau, la distance critique de façon à ce que la pensée hégémonique nivelante n’envahisse pas la conscience et, en même temps, de manière à ce que la culture des autres peuples et pays confère un plus grand sens à la nôtre. L’un des plus grands linguistes du XXe siècle, le roumain Eugen Coseriu, définissait le dialecte comme « un système d’isoglosses inclus en une langue commune » (« Los conceptos de « dialecto », « nivel » y « estilo de lengua » y el sentido propio de la dialectología, in Lingüística española actual, 3, 1981, 1-32). Définition dans laquelle il faut préciser que, par « langue commune », on doit entendre la langue officielle d’un pays qui inclurait en lui-même « ses » dialectes. En premier lieu, il faut dire que les linguistes ne précisent pas quelles sont les limites qui séparent langue commune et communauté linguistique, alors même que la différence est tout à fait notable sur le plan des identités locales et des hégémonies contemporaines de langue et de culture dans le village planétaire, jusqu’à étendre de façon démesurée les isoglosses de l’anglo-américain. En outre, on ne comprend pas le sens qu’il faudrait donner au terme « inclusion ». De quelle façon, par exemple, le napolitain serait-il « inclus » dans l’italien ? Il n’apparaît pas qu’il y ait une interpénétration stable ou fonctionnelle des deux langues, même si il y a eu depuis toujours des emprunts réciproques et des échanges lexicaux. L’inclusion est tout au plus un phénomène lié aux relations entre un langue régionale et ses variantes, mais ne correspond pas à toutes les formes de contact et donc ne peut être un critère universel de désignation.
Dans toute cette confusion il y a enfin l’effort de sincérité qu’il faut reconnaître à trois célèbres linguistes comme Corrado Grassi, Alberto A. Sobrero et Tullio Telmon, qui ont affirmé que « les conditions effectives d’usage de la part des locuteurs sont les seuls critères universellement valides pour établir quelle relation chaque variété linguistique singulière entretient envers les autres du même répertoire et, en particulier, pour distinguer une langue d’un dialecte. Aucun des autres critères qui ont été invoqués au fil du temps et le sont encore aujourd’hui pour expliquer ou mettre en discussion une telle distinction ne tient [...] » (Fondamenti di dialettologia italiana, Roma-Bari, Laterza, IV ed., 2001, p. 17. Les italiques sont le fait des auteurs). Une telle déclaration dément entièrement la prétention nobiliaire qui préside à la notion de dialecte invoquée par De Blasi comme réponse « à l’exigence d’une clarté descriptive scientifique » appartenant « à une tradition scientifique consolidée et partagée ». Tradition dont on exigera le respect sans plus attendre, comme il convient à l’honneur des lignages nobiliaires. Toutefois la polémique concerne ici le domaine des linguistes, et certainement pas celui des philosophes et des historiens des idées, auquel appartient Jean-Pierre Cavaillé. Nous ne pourrons que nous en réjouir, parce que le progrès des sciences advient, depuis que le monde est monde, uniquement grâce aux défis, controverses, débats, conflits conduits à coups d’argumentation, d’hypothèses, de théories.
En ce qui me concerne, comme simple logophile, c’est-à-dire amoureux de tout langage et en particulier de termes et de notions, je veux rappeler comment, à propos des définitions nominales, les maîtres médiévaux des scholae distinguaient avec la plus grande attention la quidditas, c’est-à-dire l’essence substantielle de la chose nommée, de la quodditas, autrement dit la simple existence, ou plutôt « être-là » de la chose elle-même. La quiddité exprime donc ce que la chose désignée est nécessairement, alors que la quoddité renvoie à son aspect contingent. De sorte que le mot de dialecte, comme il est « couramment utilisé dans les études linguistiques scientifiques », pour le dire avec De Blasi, ou bien est un doublon pour langue, en ce qui concerne sa propre essence substantielle, ou bien nomme une autre essence. Le fait que l’espèce humaine est capable de langage articulé est universel. Universel encore le fait que chaque peuple ait sa propre langue qui se diversifie en dialectes. Et cependant, il n’y a en cela rien de contingent. Dans la production quotidienne et immatérielle des langues la contingence est seulement la diversification historique et sociale de chaque langue, comme l’a dit Giambattista Vico en 1744. Contingentes sont aussi les variétés phonomorphologiques diatopiques qui font apparaître en chaque langue les formes dialectales singulières qui s’en détachent et se reconnaissent en elle au fil du temps. Ainsi du latin, par exemple, se détache en tant que langue le napolitain, sur la base originaire de la langue osque et par les influences successives d’autres langues, donnant lieu à son tour à des formes voisines et bien localisées de dialectes et variantes autonomes.
Si on ne considère pas les choses en ces termes objectifs, on pourrait dire que les linguistes font de chaque langue une Babel. Même si le dénominateur universel du dialecte était véritablement exprimé uniquement par l’exiguïté de l’espace nous ne devrions alors pas pouvoir appeler langues celles qui actuellement sont en train de disparaître, parce que parlées par des peuples soumis à une invasion culturelle. Si par contre nous acceptions le critère d’une langue considérée comme telle seulement en tant que propre à une nation ayant une autonomie étatique, alors, pour donner un seul exemple, voici que le lapin du dialecte chinois de Taiwan sortirait du chapeau des linguistes. Là où ceux-ci ont cru faire de l’ordre, en imposant des termes précis qui en réalité ne précisent absolument rien, nous sommes dans un méli-mélo général. Si l’on appelle le napolitain dialecte, alors on devra peut-être nommer sub-dialecte ou d’une autre façon les parlers de Caivano ou de Procida ? Et par quel miracle, au contraire, appellera-t-on langues toutes celles qui se parlent dans la nation ibérique ? Le castillan, en fait, est une langue officielle de l’État espagnol et tous les citoyens « ont le devoir de la connaître et le droit de l’utiliser » (art. 3 della Constitucion española), cependant, par la loi et dans l’opinion publique, celle-ci vit auprès d’autres langues reconnues comme telles par les communautés autonomes, comme le catalan, le gallego, le bable, l’aragonais et d’autres encore. Et ceci avec la bénédiction et la fausse conscience des linguistes de notre belle Italie.
En fonction de tout ce qui précède, je crois que l’unique évidence dans le rapport entre dialectes et langues selon la terminologie courante est celle d’une relation de subordination idéologique des premières par rapport aux secondes et ceci de manière tout à fait impropre si l’on considère les réalités linguistiques locales. Un tel rapport de pouvoir peut et doit être aboli, en conservant l’officialité de l’italien et élevant au statut de langues régionales les plus importants idiomes de la République, dans le plein respect de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, de la même façon que les diverses régions décident dans une souveraine autonomie quels noms donner aux différents ensembles linguistiques de leur propre territoire, aux sous-ensembles particuliers et à leurs respectives fonctions sociales et culturelles. Le napolitain a toutes les qualités pour se dire langue avec tout ce que cela implique. Il n’est pas en effet une modalité ou une variété de l’italien, aussi bien l’italien standard que l’italien historique, et il ne se soumet pas à l’officialité de l’italien parce que la langue nationale jouit d’un prestige supérieur, mais seulement du fait d’un prêt à l’usage plus avantageux. Du reste, l’immense majorité de l’agir communicationnel en italien des millions de personnes qui ont le napolitain comme langue d’origine a bien lieu dans la langue nationale, mais en une variante de celle-ci. Enfin, je suis de l’opinion qu’entre dialecte et langue, il ne peut y avoir aucune différence substantielle ; les deux notions ont le même sens, excepté le fait que si chaque dialecte est langue, il n’est pas vrai pour autant que toute langue soit un dialecte (au moins en cette phase historique) ; un dialecte est langue même si on le considère comme une variante subalterne d’une langue de valeur supérieure (comme il advient à chaque dialecte de la langue napolitaine et il comme il advient du napolitain et du florentin comme formes dialectales originaires du latin) ; une langue n’a rien d’excellent ou d’exceptionnel du fait d’être une partie dans un ensemble historique de langues voisines et interdépendantes dont font partie aussi les dialectes (sont ainsi, en fait, l’italien, le napolitain et d’autres idiomes d’Italie, comme aussi le français et l’espagnol, avec leurs langues régionales et dialectes respectifs) ; l’excellence même de l’italien littéraire et de l’italien scientifique consiste en entier dans l’être des variantes (dialectales) de la langue standard nationale.
Amedeo Messina, 2007
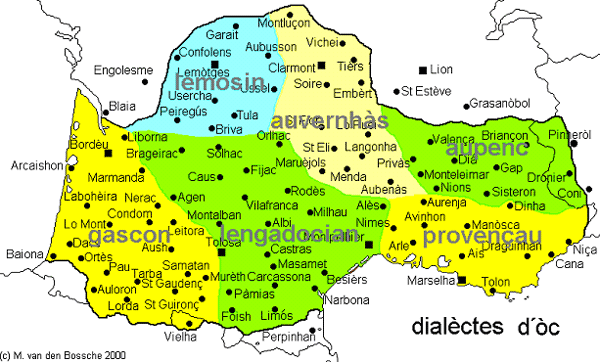
[1] Cit. in M. Cortelazzo, Avviamento critico allo studio della dialettologia italiana, Pisa, Pacini, 1969, p. 13.




/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F92%2F115864%2F129054934_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F17%2F115864%2F123220527_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F11%2F115864%2F104040903_o.jpeg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F46%2F51%2F115864%2F103970826_o.jpeg)