« Patué » d’écrivain

Je voudrais évoquer ici un article récent consacré au « patois ». Il s’agit, cette fois, non d’un texte théorique, mais d’un essai littéraire, d’une qualité stylistique indéniable, sur la langue entendue en Auvergne durant l’enfance ; une langue saisie du dehors et dans le souvenir, une langue lointaine, au bord de l’effacement, s’il est vrai que l’auteur, Thierry Laget, dit n’en retenir que douze mots : « Douje mou de patué », comme porte le titre, dans une graphie qui, à elle seule en dit long[1]. Ce texte forge quelques paradoxes, tout à fait révélateurs de ce que le patois, dès que le mot est formulé, chargé comme il l’est de connotations pluriséculaires, ne peut pas ne pas être. Ces paradoxes, dont on trouverait sans doute quelques formulations moins audacieuses chez des auteurs limousins comme Pierre Michon, Richard Millet et Pierre Bergounioux, viennent de ce que le « patois », loin d’y apparaître comme une sous-langue, un idiome avili et méprisé, y est choyé, honoré, célébré et même, on le verra, porté aux nues… Non parce que son statut de langue à part entière y serait établi (il n’est fait aucune référence d’aucune sorte à l’appartenance des parlers auvergnats au monde occitan), mais en tant que « patois », langue des humbles, des ruraux, sans écriture, consubstantielle à l’oralité. Mais le choix, conscient et délibéré – l’auteur critique rétrospectivement sa propre rébellion d’adolescent, au début des années soixante-dix, contre l’usage du terme[2] – de n’appeler cette langue entendue en son enfance qu’avec le mot qu’utilisait son grand-père (et aujourd’hui encore beaucoup de ceux qui parlent non seulement l’occitan, mais bien d’autres langues de France aujourd’hui), semble impliquer que l’auteur demeure étroitement tributaire de la plupart, sinon de toutes les connotations négatives irrémédiablement attachées au vocable. Ainsi, ce beau texte est-il on ne peut plus révélateur des apories indépassables auxquelles conduit son maintien, à toute force, en littérature comme en linguistique, malgré l’évidence du fait que, une fois affranchies de la relation de domination, les langues minorées de l’espace national ne peuvent plus, décemment et sensément, se nommer « patois ».
L’autre nécessaire
Ces connotations, foncièrement étrangères à la réalité linguistique des langues désignées par ce terme intraduisible et si difficilement transposable à toute autre forme de construction historique, se ramènent toutes à la fonction négative du patois, à l’altérité linguistique, contre laquelle, vis à vis de laquelle, en chaque espace du territoire national, le français s’impose avec toutes ses vertus et ses excellences. Sans le patois, le français ne pourrait pas être ce qu’il est, il ne pourrait se définir, comme il le fait, à travers une série de lieux communs, eux-mêmes étrangers à toute réalité linguistique : la clarté, l’intellectualité, la rationalité, l’élégance, la beauté, des qualités intrinsèquement littéraires, voire philosophiques, l’unité, et même l’unicité, et avec cela l’universalité, qui est avec la langue, celle d’un idéal moral et politique. Le patois est son « autre » nécessaire. C’est dire le désarroi et même la fureur de ses idéologues, parmi lesquels certains linguistes ne sont pas en reste, lorsqu'on vient leur dire que le patois n’existe pas en dehors de cette modalité du négatif nécessaire. C’est-à-dire que le terme n’a aucune pertinence scientifique, qu’il ne correspond, selon les définitions courantes ou linguistiquement élaborées qui en sont données, à aucune description un tant soit peu fidèle des langues amalgamées, confondues et minorées sous ce terme. Par contre, dès que l’on dit « patois », en particulier pour désigner la langue que l’on parle, on épouse nécessairement, ou du moins accepte-t-on d’adopter le point de vue du français hégémonique sur les idiomes que celui-ci a réduit, au terme d’un long combat, à ce statut infime, erratique et indéterminé, quelque part entre bruit et langue.
Cela n’empêche pas, certes, de jouer sur le mot et de ruser avec le rapport de soumission qu’il implique, de subvertir cette insuffisance et cette humiliation consentie, en affirmant, dans la parole et parfois l’écriture, une identité fût-elle négative, en invoquant, à titre d’excuse, sa propre infériorité, irréductible à la culture maîtresse portée par le français. Car, du fait même de sa position de faiblesse, d’ignorance et de grossièreté prétendue, le patois peut, ou du moins a pu (car la culture patoisante est, on peut le dire, partout en France moribonde), être un lieu privilégié pour l’expression de bien des choses exclues ou censurées dans la langue noble, un moyen de liberté sans aucun doute, des formes d’humour, des manières de dire le corps et le sexe, de pratiquer, vue d’en bas, une redoutable critique sociale, des biais de mécréance, etc. Sans compter le fait que le patois, contrairement au mythe répercuté par les linguistes qui conservent le mot, est toujours, jusqu’à son dernier souffle, dans la bouche de ses locuteurs (c’est-à-dire, de ceux qui parlent ou ont parlé des langues en fait entièrement différentes les unes des autres, dans des situations diversifiées, mais en identifiant eux-mêmes cette parole comme patoise), langue de part en part, c’est-à-dire non pas un idiome spécialisé (réservé aux travaux des champs lit-on souvent), mais l’outil disponible pour dire tout ce qu’il y a à dire, quitte à en farcir le lexique de francismes, en cas de besoin[3].
Ce texte montre que l’on n’échappe pas aux préjugés et aux lieux communs qui lui sont associés, en se proposant de rendre justice au patois, d’en dire la dignité, voire la noblesse, si l’on ne se donne la peine de produire une analyse critique de la notion. Aussi, cet éloge du patois n’est, ne pouvait être en fait qu’une célébration du français, pratiquée de manière performative dans la production d’un texte où, en regardant le patois du dehors, certes avec une grande bienveillance et tendresse, avec une sorte de piété filiale, par différence et opposition, la langue littéraire, dans une recherche stylistique exigeante, se regarde et contemple elle-même, avec une complaisance toute narcissique. Car, en réalité, il n'est donné que la part la plus congrue, la plus minime qui soit à cet autre, et il n’est, de toute façon, pas question de le découvrir, de l'explorer ou de se l’approprier. Une fois de plus le patois est le faire valoir le français.
Langue du Ciel
Je citerai pour commencer un essai de description du patois auvergnat : « Cette langue énergique et douce, tout en glissades et à saute-mouton, évoque d’abord l’écholalie d’un nourrisson. On aperçoit un glouglou, des éclats de rire dans des mots qu’ils éclairent de l’intérieur, telles des lanternes sourdes, des tendresses, des mièvreries, puis des bousculades de ch, de ts, qui colorent l’énoncé d’une lueur plus sombre, plus dramatique, tantôt frondeuse, tantôt sceptique, avant d’intimer silence au parleur. Il s’agit de dire et de ne pas dire, d’approcher et de s’éloigner, de comprendre et de ne pas dévoiler des nuances trop subtiles pour des oreilles profanes. Il faut se faire entendre aussi des animaux, et d’eux surtout qui furent les premiers à maîtriser l’idiome » (p. 20). Est décrite, de manière d’ailleurs fort talentueuse, la manière dont la langue est perçue par une oreille française qui n’en pénètre pas, ou du moins très imparfaitement, le sens : c’est la musique de la langue qui est alors évoquée, non sans virtuosité, et la mécompréhension de l’auditeur est projetée dans la langue elle-même, comme l’un de ses caractères propres : le patois est élevé au rang de langue secrète et de langue mystique, inaccessible au profane.
Laget va même jusqu’à dire, très joliment d’ailleurs, qu’elle est la langue du ciel : « Pour moi qui la considérais d’en bas, la main dans celle de mon grand-père, c’était également la langue du Ciel. Chacun des mots qui a constituaient était un ostensoir, où se donnaient à voir les mystères du monde, aussi rayonnants que s’ils avaient jailli du tabernacle, des ciboires où macéraient des vérités aigres et opalines… » (p. 21). Le patois mal compris, mystérieux, devient une langue sacrée, la langue des mystères du monde, et les saints brimborions de l’église de village ne sont pas de trop pour désigner la parole grand-paternelle. La raison de cette perception du patois comme une langue à mystère est cependant énoncée sans détour : le refus générationnel des locuteurs de transmettre leur langue à l’enfant : « ils savaient observer le silence avec ténacité : rien au monde ne les en aurait fait démordre » (p. 20) ; « ainsi me remettait-on toujours à ma place : avec les enfants, dont ma grand-mère trouvait à juste titre qu’ils étaient trop innocents pour entendre la langue des dieux… », (p. 24) ; « le peu qu’il en reste aujourd’hui suffit à mon festin, car loin de m’exclure, cette langue – qui me disait pourtant : « pas toi » - suscitait ma dévotion » (p. 23). La dévotion, sentiment plus élevé certes – mais peut-être plus délétère encore – que le dépit, est pourtant le produit de l’exclusion du profane à participer à la célébration des mystères : « pas toi » ! Car si le patois dit « pas-toi », exclusion il y a : le texte est sur ce point contradictoire. Il est étonnant de trouver ici engagée, pour chanter le patois et justifier en même temps le fait que cette langue ne saurait pour l’auteur être autre chose que cette petite collection de reliques (« le peu qu’il en reste aujourd’hui suffit à mon festin »), la psychologie du croyant, qui désire être mystifié et s’interdit l’approche du tabernacle, se contentant d’adorer les maigres fétiches qu’on lui laisse effleurer du regard et des lèvres. Sauf que, évidemment, cette religion n’en est pas une, mais tout au plus une posture esthétique, et les prêtres putatifs, des gens qui pour des raisons en effet complexes, mais en tout cas psychologiques et sociales et non mystiques, ont choisi spontanément, massivement de ne pas transmettre la langue. Tout cela est évident pour l’auteur lui-même, lorsqu’il se demande pourquoi sa grand-mère ne parlait le patois (du reste, si elle l’avait parlé, et donc si le jeune Thierry l’avait entendu communiquer avec son mari, je gage, comme ce fut mon cas exactement dans les mêmes années, que le « patois » n’aurait aujourd’hui guère de secret pour lui, malgré le déni de transmission) : « Dans cette pastorale, la place des femmes était mal assurée : le prestige et les promesses du français étaient plus puissants, chez elles que l’allégeance aux traditions. Savaient-elles qu’avec l’auvergnat on ne sortait pas de sa condition ? […] Ma grand-mère […] ne parlait pas le patois, quoiqu’elle le comprît parfaitement » (p. 25). Elles savaient, en effet, croyaient savoir, qu’avec le « patois », on ne sortait pas de sa condition : et c’est bien sûr la raison (que l’on m’excuse de dire ce qui n’est que pudiquement élidé dans le texte) pour laquelle on n’a pas transmis la langue aux enfants de cette génération…
Écholalie, langue des bêtes, langue de Cratyle sans méthode ni grammaire
Du reste, cette élévation, cette canonisation du patois n’empêche certes pas la réitération d’idées anciennes[4] ; celle qui associe d’abord le patois à l’enfance. Sorte d’ « écholalie » de nouveau né, le patois serait une sorte de langue native, originelle, un commencement de langue ; l’idée, ensuite, selon laquelle le patois est un langue pour les animaux et même une langue d’animaux, idée plus prosaïque, facile à transmuter en célébration de sa divine naturalité, un peu franciscaine, un peu animiste, un peu panthéiste… Le patois est la langue de la terre, qui fait corps avec ce qu’elle dit : « Le patois devenait tour à tour ligneux, minéral, émietté ou carié, se confondant avec ce qu’il désignait, bien adapté à son milieu, impénétrable, idéalement moulé sur son objet – non, Cratyle ne s’en serait pas mieux tiré. » Le patois, langue native, primitive, naturelle, sauvage, antérieure à l’arbitraire du signe : le patois réalise le cratylisme, mais cette vertu mirifique du patois, dire les choses mêmes, parce qu’il tient lui-même aux choses, parce qu’il est une langue animale et concrète, n’est que l’inversion positive de ce que le mot véhicule en fait de plus négatif : à savoir la réputation d’être une langue incapable d’abstraction, une langue avec laquelle on ne pense pas, toute aux choses et aux gestes, l’idiome de l’inculture et de l’ignorance même ; « sans grammaire ni méthode », comme l’écrit l’auteur. Une langue sans grammaire ni méthode (qui ne voit en creux, par opposition, l’autocélébration de la langue grammaticale et méthodique par excellence – du moins dans la représentation qu’elle cultive d’elle-même ?), poncif éculé inséparable du préjugé selon lequel le patois ne s’écrit ni ne s’enseigne ; évidemment la grammaire, il suffit de l’en extraire et elle s’avère alors aussi rigoureuse et méthodique que n’importe quelle autre, mais alors, une fois que le patois est devenu, par cette seule conscience de la grammaticalité constitutive de toute langue, un idiome possible d’enseignement et de culture savante, l’usage du terme, notons-le, devient presque impossible. Ce préjugé a bien sûr une raison d’être ; à savoir le statut factuel des langues minorées en situation d’extrême diglossie, délibérément abandonnées à la seule transmission orale, dans un régime général de montée en puissance de l’écriture et de l’apprentissage scolaire. Mais il s’agit bien d’un préjugé, puisqu’il essentialise ce statut contingent d’une langue, dominée par une autre, exerçant le (quasi)monopole de l’écriture et de la transmission institutionnelle ; cependant, il ne faut pas confondre le statut social, dans l’histoire, des langues nommées patois et leur être ou plutôt leur devenir possible. Il faut appliquer à la prétendue impuissance, faiblesse culturelle du patois, comme à son exhaussement naturaliste ou primitiviste, les mêmes critiques, accomplies et achevées depuis belle lurette, que l’on a pu formuler à l’égard des préjugés sur la féminité, l’homosexualité ou la négritude, irrémédiablement invalidantes même, et surtout, dans l’effort déployé pour en inverser le sens.
« A la taille de l’homme »
Certes Laget ne parvient pas non plus à se satisfaire de ces poncifs, et c’est bien la raison pour laquelle il tente de les inverser. N’en vient-il pas à reconnaître que le patois, tout simplement est à taille humaine ? Mais l’aveu qu’il fait alors en dit long : « J’ai longtemps cru que le patois ne pouvait manifester que le corps, ses besoins, la matérialité du monde (qui n’est pas dénuée d’énigmes). Aujourd’hui, je comprends qu’il était à la taille de l’homme, qu’on pouvait le regarder dans les yeux et s’y voir reflété » (p. 26). Nous sommes apparemment dans un schéma dualiste ; le corps d’un côté, dont l’auteur crut longtemps que le patois était la langue naturelle (mais comment pouvait-il alors, ou est-ce à un autre moment, s’insurger sur l’usage du terme ?), et ce supplément d’âme qui fait qu’on regarde l’homme dans les yeux, sans doute longtemps réservé aux seules langue nobles, le français d’abord, ou l’italien, que pratique aussi Laget, jusqu’à ce qu’il se rende compte que le patois est exactement à taille humaine.
Fort bien, encore faudrait-il en tirer les conséquences et mettre en question aussi bien la divinité que le cratylisme du patois, considérer qu’il est une langue, pour l’essentiel, au même titre que les autres, ni meilleure, ni pire, mais différente, différente parce que la langue est autre (par rapport au français) et parce que la dialectalisation et sub-dialectalisation (c’est cela que nommerait le « patois » s’il pouvait être un terme neutre) est sa modalité propre, et cette différence se peut nommer et décrire avec un peu plus de rigueur, de curiosité et de générosité.
Ainsi suis-je très étonné de l’étonnement de Laget, de sa feinte naïveté devant les usages littéraires et l’étude savante du patois : « Je ne pouvais qu’être étonné quand, plus tard, je découvris les Chants d’Auvergne de Joseph Canteloube : en concurrence avec l’italien, le français ou l’allemand, la langue du bougnat triomphait sur les scènes d’Opéra […] Qu’aurait dit mon grand-père s’il avait su que son pauvre patois prenait l’avion, descendait à l’hôtel, que des cantatrices faisaient venir sous tous les climats de la planète des répétiteurs d’auvergnat qui leur inculquaient la prononciation de Saint-Flour, l’accent de La Bourboule, qui leur apprenaient à chanter sans emphase le charabia du marchand de charbon ? » (p. 25). Qu’aurait-il dit en effet ? Ou plutôt qu’en disent ceux qui le parlent encore, beaucoup plus nombreux que ne semblent le dire Laget, qui semble croire que son patois chéri est mort avec son grand-père ? Hé bien, selon une enquête très récente, 71 % des auvergnats sont favorables au maintien et à l’enseignement de la langue[5]. Cela me semble impliquer, nécessairement, ce recul critique à l’égard de ce que l’on a jusqu’ici appelé patois que refuse d’accomplir l’auteur au nom de la « dignité » et de la « beauté » du mot. Sinon, il ne serait ni étonné par Canteloube, ni par l’existence du dictionnaire de Karl-Heinz Reichel[6]. De celui-ci, il écrit en effet : « Aussi suis-je surpris, ce matin, de voir qu’on consacre un volume entier – 900 pages, 90 000 mots – à une langue qu’il fut, en vérité, seul à parler » (p. 26). Cet unique locuteur est son grand-père, et il s’agit, bien entendu, d’un effet de style ; l’auteur restant fermement accroché à son histoire privée, et cela est évidemment son droit sacré d’écrivain, mais le prix de cette restriction du propos à la seule évocation de l’intime est la reproduction, malgré l’effort de littérarisation, la recherche de quelques paradoxes esthétiques aptes à réenchanter la mémoire, des lieux communs invétérés.
Non qu’il ne fasse de très justes observations. Soit, par exemple, la description de la relation que son grand-père entretenait avec ses deux langues : « Chez mon grand-père, le français résidait dans une zone du cerveau située derrière les yeux, car c’est là qu’il allait fouiller en plissant les sourcils quand un mot se dérobait à lui ; à l’inverse, le patois était inscrit dans sa chair, les organes de la phonation s’étendaient des orteils à la pointe du nez : cette langue faisait corps avec lui, il n’y avait pas de jour, pas d’interstice entre eux, ils avaient été façonnés de pair, elle sur lui, comme un portrait sur son modèle » (p. 25). Cette description est d’abord celle la situation de bilinguisme diglossique, chez un locuteur dont la première langue est la langue dominée et la seconde, la difficile, la lointaine langue maîtresse. Elle est ensuite le constat que l’on peut faire au sujet de n’importe qui parlant sa langue maternelle, car il n’y a aucune raison de dire que seul le patoisant, dans la parole, fait corps avec sa langue et réciproquement. J’ajouterai cependant que cette manière d’identifier l’homme et sa langue me semble, à moi, très abusive ; car notre parole, justement, par tout ce qu’elle dit et ne dit pas, excède la langue qu’elle incarne. Nous avons toujours des choses à dire auxquelles résiste(nt) la (ou les) langue(s) que nous parlons ; il y a entre moi et la langue que je parle, ce jeu, cet écart nécessaire sans lequel ce que je tente de dire n’aurait de sens pour personne. Il n’empêche que la métaphore du « faire corps » avec la langue est en effet très signifiante, à condition de l’étendre, encore une fois, à toutes les langues, quelles qu’elles soient, lorsqu’elles sont portées par leurs locuteurs natifs.
Je voudrais enfin citer une autre remarque, d’une vérité confondante et dont on peut faire d’ailleurs une appropriation parfaitement matérialiste ; elle suffit, à elle seule, à recommander la lecture du texte de Laget : « Il faut aimer les livres, ainsi que je le fais, naïvement, pour imaginer que l’âme s’éternise parmi nous grâce aux mots ; elle n’a jamais été que là, en eux, et quand ils se taisent, la voilà qui meurt pour toujours » (p. 27). En effet, la langue vit en nous, non parce que nous l’écrivons – car cette vie de l’écriture est une vie par procuration, ou une vie posthume – mais pour autant que nous la parlons ; en ce sens en effet la langue fait corps en nous et avec nous.
J.-P. Cavaillé
[1] Thierry Laget, « Douje mou de patué », Théodore Balmoral, revue de littérature, n° 52/53, 2006, p. 19-27.
[2] « Le plus lumineux de tous, c'est le mot de « patué » qu'à seize ans je suppliais mon grand-père de ne pas employer (voulant rendre à l'homme, à sa langue, une dignité qu'ils étaient à cent lieues d'avoir perdue) et qui, aujourd'hui, me paraît désigner exactement ce qui a disparu : la fierté d'être au rang des humbles », p. 27.
[3] Voir, sur ce blog, l’essai de discussion : Vous avez dit patois ?
[4] Voir à ce sujet l’excellent article de Jean-François Courouau : « L'invention du patois ou la progressive émergence d’un marqueur sociolinguistique français XIIIe-XVIIe siècles », Revue de Linguistique Romane n°273-74, 2005, p. 185-225.
[5] Langues et cité, bulletin de l’Observatoire Linguistique, n° 8, 2006.
[6] Que Le Dictionnaire général auvergnat-français (2005), soit édité par le l’association Terre d’Auvergne, n’est pas ici décisif. En effet, malgré leurs relents identitaires fort déplaisants aux narines du métèque invétéré que je suis et l’affirmation de l’existence d’une langue auvergnate qui n’aurait rien à voir avec l’occitan, au moins Terre d’Auvergne parle-t-elle de langue et non de « patois ». Voir le mot de « patois » dans le lexique que le groupe propose, mais aussi l’affligeante définition d’« occitan et occitanie ».

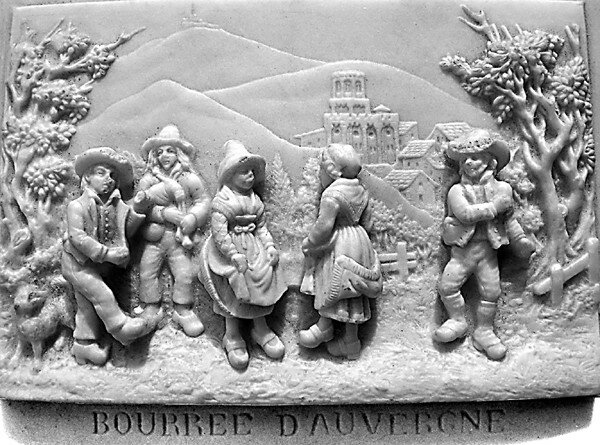


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F92%2F115864%2F129054934_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F17%2F115864%2F123220527_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F11%2F115864%2F104040903_o.jpeg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F46%2F51%2F115864%2F103970826_o.jpeg)