Mythes officiels, mythes alternatifs. Histoire de France, histoire d’Occitanie

Charles Martel "arrête" les arabes à Poitiers (tableau de Charles-Auguste Steuben 1837)
l'un des nombreux mythes de l'histoire officielle de France
Labouysse versus Lavisse
Je viens de lire un livre récent de Georges Labouysse, Histoire de France. L’imposture. Mensonges et manipulations de l’histoire officielle (IEO Éditions, 2007) et j’en ai complété la lecture par la participation, vendredi dernier, à un débat public qui lui était consacré à Limoges en présence de l’auteur, organisé par le Cercle Gramsci et l’Institut d’Études Occitanes du Limousin.
Parler de ce livre et de cette conférence, je préfère le dire d’emblée, me place dans une position difficile. En effet, je partage avec l'auteur à peu près les mêmes engagements et je suis moi aussi convaincu de la nécessité et de l’urgence du travail de déconstruction des mythes officiels de l’histoire de France, sans lequel tout effort pour faire avancer la cause des langues minorées dans ce pays est condamné par avance, car ces mythes excluent et légitiment l’exclusion d’une telle reconnaissance. J’ai en outre le plus grand respect pour Régions et Peuples Solidaires, mouvement dans lequel milite Labouysse. Pourtant, j’ai de nombreuses critiques à formuler, car le livre me paraît souvent, par la légèreté de ses instruments d’analyses et un usage à mon avis trop peu rigoureux des termes et des notions, desservir une cause que je partage sans restriction. Mais, à la fois, j’ai bien conscience – et j’ai pu le constater lors du débat – que ces critiques, mêmes assorties de toutes les précautions, ne peuvent pas ne pas en fait laisser penser à nos adversaires jacobins, qu’ils ont raison, c’est-à-dire que leurs propres mythes sont supérieurs à nos arguments, et que cette supériorité s’éprouve, selon eux évidemment, à leurs bons effets politiques ; en particulier le verrouillage, double, triple verrouillage de la question des minorités culturelles et linguistiques.

Minorités ?
« Quelle place pour les minorités nationales dans l’Histoire de France ? ». C’est la question qui servait de titre à la conférence de G. Labouysse, dont le texte constitue la première partie du livre, la seconde étant occupée par une très abondante anthologie de textes, qui illustrent et nourrissent son propos. La réponse est résolument négative : « aucune… ou presque ! »… On ne peut que partager le constat, mais je note d’emblée l’ambiguïté ou plutôt la maladresse de l’expression « minorités nationales » : signifie-t-elle « minorités » au sein de la nation française, ou « minorités » représentant des nations potentielles au sein de France ? Dans ce second cas, il faudrait tout de suite définir ce qui est entendu par « nation ». De toute façon l’exclusion des minorités ne concerne pas seulement, en France, celles des langues et cultures « historiques » de la France, mais aussi toutes les autres, visibles ou invisibles, culturelles ou sexuelles, etc. Ainsi, la question de fond est bien celle d’envisager pourquoi le concept de « minorité » est politiquement et je dirai même philosophiquement banni en France : c’est sur lui, n’oublions pas, qu’a achoppé, entre autres, la ratification française de la charte européenne des Langues régionales et minoritaires. Les notions d’égalité des citoyens, d’unité et d’invisibilité de la République, telles qu’elles sont entendues par la tradition jacobine dominante, excluent a priori la possibilité de reconnaître l’existence de minorités. Les grands principes abstraits, obèrent et excluent le réel. Pour cette idéologie là, il ne peut pas, il ne doit pas y avoir de minorités ; s’il y en avait, la République ne serait plus elle-même. C’est pourquoi, la simple constatation selon laquelle l’histoire de France ne fait aucune place aux minorités est insuffisante.

Vincingétorix dépose ses armes devant César
Impostures ?
De même, on ne peut se contenter, à mon sens, de dénoncer « impostures, mensonge et manipulations de l’histoire officielle », puisque tel est le titre de l’ouvrage. On pourrait dire que c’est là le lot de toutes les histoires nationales, et l’on en trouverait alors aussi bien dans les ébauches d’une histoire nationale occitane (voir infra)… Il faudrait, je crois, s’interroger d’abord sur les mécanismes de constitution d’une histoire nationale mythique et sur ce qui fait d’ailleurs que l’expression même d’histoire nationale mythique soit une forme de pléonasme. Si l’on ne se pose pas cette question, alors on se précipite tête baissée dans une histoire mythique alternative (infra). C’est pourquoi je n’aime pas le titre de ce livre, parce qu’il fait irrésistiblement appel à la rhétorique et à la théorie du complot, là où il s’agit de bien autre chose et de processus autrement redoutables et efficaces que ceux du complot et de la conspiration, qu’il suffirait de confondre et de dénoncer pour en venir à bout. Les mécanismes de constitution du mythe national sont autrement complexes, qui intègrent en effet l’idée d’une manipulation moralement et politiquement nécessaire et légitime du passé. Deux passages de Renan, tirés de Qu’est-ce qu’une nation ? sont particulièrement éclairants : « L’oubli, et je dirai même l’erreur historique [doux euphémisme pour dire le mensonge historique[1]], sont un facteur essentiel de la création d’une nation. Et c’est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. L’investigation historique, en effet, remet en lumière des faits de violence qui se sont passés à l’origine de toutes les formations politiques, même de celles dont les conséquences ont été le plus bienfaisantes. L’unité se fait toujours brutalement ; la réunion de la France du Nord et de la France du Midi[2] a été le résultat d’une extermination et d’une terreur continuée pendant près d’un siècle. » ; « [...] l’essence d’une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses. Aucun citoyen français ne sait s’il est burgonde, alain, taïfale, wisigoth ; tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélemy, les massacres du Midi au XIIIe siècle »[3].
Cette conception de l’histoire nationale comme pieux mensonge et oubli nécessaire, qui rappelle les « nobles mensonges » dans la République de Platon (le « mythe » de l’autochtonie, etc.), a-t-elle aujourd’hui disparue, alors que semble triompher l’idée que rien n’est pire que l’oubli imposé, le refoulement du passé qui ne passe pas, sans parler de l’injonction éthique d’un « devoir de mémoire » ? Rien n’est moins sûr car, foncièrement, substantiellement, les mécanismes restent les mêmes : le travail de falsification et de refoulement se poursuit au nom des grands principes républicains eux-mêmes. Reconnaître l’existence de différences, et de groupes de citoyens dominés par d’autres et dont la domination est soit niée, soit légitimée, une telle reconnaissance, soi-disant, ruinerait l’égalité et la fraternité, et même – pourquoi non ? – la liberté. La liberté du citoyen, n’est-elle pas celle de tous ces attachements communautaires (à l’exception bien sûr des liens infrangibles qui l’attachent à la communauté nationale unie par l’idéal républicain) ? Ce n'et pas l'un des moindres paradoxes de la conception jacobine de la liberté, que de « forcer » le citoyen « à être libre », pour reprendre la formule célèbre de Rousseau, en l'arrachant à tous ses liens corporatistes et plus gnéralement communautaires...
L’historien, de ce point de vue, est un empêcheur de tourner en rond. Il ne peut pas ne pas se demander, même s’il est occitaniste, comme je le suis, si le récit ou les récits qui constituent l’imaginaire historique occitan sont plus vrais, moins mythifiés, que ne le sont ceux de l’histoire officielle de France. A commencer par l’idée qu’il a existé une civilisation occitane nimbée de toutes les qualités éthiques, esthétiques et politiques, antérieurement au désastre de la croisade et de l’annexion (infra).
Labouysse dénonce l’histoire mythique inventée au XIXe siècle par Ernest Lavisse et consort, d’une France éternelle : ancienne Gaule dont les contours étaient déjà ceux de l’hexagone, puis Franque et chrétienne (les wisigoths ariens, autrement plus puissants que les Francs, étant passés sous silence), avec l’exaltation obligée des croisades puis, surtout de la colonisation, assortie de la rhétorique des « devoirs » et donc des « droits » des « races supérieures » envers les « inférieures » (Jules Ferry[4], etc.). Certes, cette critique doit être menée sans concession. Mais on ne peut nier que le discours des manuels, depuis Lavisse, s’est considérablement déplacé. Sur certains plans, il est même possible de parler de révision, en particulier concernant le colonialisme, malgré les tentatives politiques d’en imposer l’éloge rétrospectif. Ce qui n’a guère évolué est la conception hexagonale, centraliste, monolingue et monoculturelle de cette histoire. Or je suis étonné que Labouysse, justement, ne cite pratiquement pas dans son livre les manuels d’histoire récents (il a en pris par contre plusieurs exemples lors de sa conférence), qui permettrait de montrer à la fois ce qui bouge et ce qui persiste de cette mythographie. Il serait tout à fait intéressant et nécessaire de conduire ce travail de manière systématique ; l’analyse en serait sans doute plus difficile que celle du manuel de Lavisse, parce que l’idéologie centraliste s’est faite plus prudente et plus insidieuse, qui passe par le vocabulaire de la décentralisation et de la décolonisation.
D’ailleurs, dans l’anthologie qui occupe la plus grand part du livre, les textes vraiment contemporains sont rares. Mais surtout, il est assez difficile de s’y retrouver. Non pas que ces textes, connus ou non, ne soient pas intéressants et pertinents sur la question. Mais l’effort de présentation, de contextualisation et de mise en ordre thématique et chronologique est minimal et pour tout dire très insuffisant. Le lecteur ne dispose en outre d’aucun index qui l’aiderait à se repérer.

Clovis proclamé roi de France
Questions de mots
Dans le texte lui-même, malgré, je le répète, un accord de fond sur la démarche (« décoloniser notre passé et nos manuels, et reconnaître les identités et les mémoires régionales, culturelles, sociales, philosophiques et religieuse », p. 47), j’ai souvent été gêné par les raccourcis, anachronismes et amalgames dans l’usage des notions et des catégories. Cette question des mots et des concepts est pour moi essentielle, parce que les abus en ce domaine conduisent presque fatalement à des erreurs, qu’un lecteur hostile, ou tout simplement critique, pourra à son tour dénoncer comme des falsifications et des impostures. D’abord, il me semble que l’on ne puisse parler « d’atteintes aux droits de l’homme » pour les périodes historiques où cette notion n’existait pas et où de tels droits n’étaient pas reconnus (p. 22, 45, etc.). Certes, un massacre est un massacre, en quelque époque qu’il ait eu lieu, mais la manière dont il est perçu, représenté, dénoncé ou légitimé change dans l’espace et dans le temps. On ne saurait faire un travail d’historien digne de ce nom en appliquant des catégories normatives contemporaines sur les événements du passé. C’est un fait, les droits de l’homme ne sont pas applicables rétrospectivement : Simon de Monfort et Innocent III n’ont rien à craindre de la cour pénale internationale !
Il ne me paraît pas possible de dire non plus que l’Inquisition est l’ancêtre de la Gestapo (p. 25 et 36). L’Inquisition est une juridiction, la Gestapo une police politique ; l’inquisition est un tribunal des consciences contre les ennemis de la foi, la Gestapo traque des ennemis politiques non pour assurer le salut de leurs âmes (éventuellement par le bûcher), mais pour les anéantir.
Parler de prélude de l’absolutisme avec Saint-Louis (p. 26) est pour le moins déplacé ; pour que l’on puisse parler d’absolutisme, il faut une conception de la monarchie, qui absolve, qui délie le monarque des lois ; il faut reconnaître au monarque une potestas absoluta, une puissance ab-solue. Cette conception du pouvoir monarchique a une histoire, et l’on ne saurait certainement pas en parler pour des périodes antérieures au XVIe siècle.
De même, on ne saurait utiliser la notion de « totalitarisme » pour désigner le régime politique de François Ier (p. 26), et pas plus pour les souverains « absolus » de l’âge moderne. L’usage du terme pour désigner les persécutions dont Louis XIV s’est rendu coupable contre les protestants après la révocation de l’Édit de Nantes, est certes emprunté à Janine Garisson, mais il est abusif. Il ne s’agit bien sûr pas de minimiser les crimes des dragonnades. Mais le totalitarisme est autre chose ; la prétention d’un pouvoir total de l’État sur la société civile, voire même le projet d’une absorption de la société civile par l’État. Un roi comme François Ier, ne disposait même pas d’une claire conception de l’État ; on ne peut donc a fortiori parler de son « totalitarisme » pour désigner en fait son autoritarisme et les mécanismes qu’il met en place pour renforcer son pouvoir personnel et étendre les prérogatives royales.
J’étendrai plus loin encore ces scrupules de langage à des expressions choc qui, sous un rapport ou sous un autre, signifient bien une réalité, mais à la fois sont susceptibles d’alimenter des polémiques stériles. Je pense d’abord à celle de « colonialisme de l’intérieur », qui a fédéré la lutte sociale et culturelle occitane dans les années 70. Certes il y a de bonne raisons de parler de colonialisme, puisqu’il y a bien imposition depuis le centre, depuis le lieu du pouvoir, d’une sujétion territoriale, économique, culturelle et linguistique. Mais alors il faut noter deux choses. D’abord que cette imposition est de fait largement acceptée par une grande majorité des assujettis (excepté peut-être en Corse, et encore…), et surtout, surtout, que ces colonisés de l’intérieur se distinguent foncièrement des colonisés de l’extérieur, en ce qu’ils sont des citoyens de plein droit au sens du droit français, qui ne reconnaît en effet nullement les droits culturels et linguistiques des citoyens. La reconnaissance d’un déficit majeur de démocratie n’autorise pas à parler de « colonialisme de l’intérieur » sans prendre la peine de le distinguer de ce qui le distingue du « colonialisme de l’extérieur ».
Labouysse parle aussi d’« ethnocide culturel ». Cette expression est elle-même gênante parce qu’elle introduit, fût-ce de manière métaphorique, l’idée d’ethnie et de cultures ethnique, à mon avis insoutenable, quelle que soit la définition que l’on en donne (mais on ne trouve nulle définition dans le texte : rien n’y est jamais défini et c’est bien là tout le problème), et tout particulièrement pour nos sociétés qui ont connu dans l’histoire, comme le montre très bien Labouysse, un brassage humain permanent.
Il m’est sans doute arrivé de parler moi-même de « génocide linguistique ». Certes, il y a bien eu et il y a encore une politique d’anéantissement linguistique, assumée comme telle, et là encore, métaphoriquement, on peut alors parler de « génocide ». Génocide est en effet un mot très fort, mais s’il en est ainsi, c’est qu’il évoque l’élimination physique de populations entières. Or, en l’occurrence, cela n’est évidemment pas le cas. Je veux dire que la politique d’anéantissement n’a pas été purement et simplement imposée aux populations ; celles-ci ont collaboré à ce processus. Après tout, il n’est pas absurde de dire qu’elles-mêmes auraient pu résister plus efficacement et durablement à cet anéantissement ; elles l’ont fait d’une certaine façon, mais elles ont fini par renoncer, là même où la langue n’était pas pourchassée : dans l’espace privée. Aussi, il me semble souvent que la métaphore de « suicide linguistique » serait moins inexacte que celle de « génocide », qui implique qu’il y ait des bourreaux et des victimes clairement désignés, alors que le procès de la mort d’une langue, lorsqu’elle n’est pas imposée par la violence (le massacre des locuteurs, la dispersion des membres, l’interdiction formelle de la parler en quelque lieu que ce soir : tout cela s’est vu dans l’histoire) est la conjonction, le plus souvent, de contraintes externes et de choix internes des groupes de locuteurs. On peut bien sûr dire que les locuteurs ont été poussés à tuer leur propre langue, puisque tout était fait pour qu’ils ne puissent plus la transmettre, mais la métaphore du génocide est gênante, alors qu’il s’agit bien pourtant d’anéantissement et d’élimination.
Je ne veux certes pas imposer une quelconque police de la langue, une forme de langage politiquement correct sur ces questions, mais je pense, qu’en ce domaine comme en tout autre, la recherche des mots justes doit être permanente et toujours à recommencer.
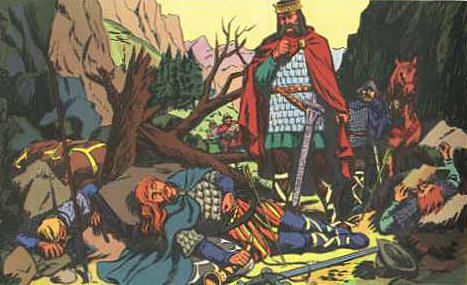
La mort de Roland à Ronceveau
Villers-Cotterêts et le francien
Ce qui m’apparaît chez Labouysse, comme un souci insuffisant d’exactitude terminologique, est inséparable d’un manque d’exigence intellectuelle dans l’analyse et la critique des mythes de l’histoire officielle.
Ainsi, l’auteur est-il plusieurs fois tributaire de l’histoire mythifiée qu’il critique.
J’en prendrai deux exemples, très rapidement, car j’ai eu l’occasion d’en traiter déjà sur ce blog :
1- L’interprétation de la fameuse formule de l’article 111 de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (« en langage maternel français »), comme visant les langues vernaculaires autres que le français, en plus du latin. Or la formule est ambiguë, peut-être délibérément, quand on sait qu’en de nombreux textes des premières décennies du XVIe siècle on considérait comme formant le langage français toutes les langues maternelles parlées en France. La seule langue d’écriture juridique, en dehors du latin (visé explicitement par l’Ordonnance), et du français proprement dit, qui existait au XVIe siècle, l’occitan, ou plutôt ce qu’il en restait, puisque on sait que ces écritures juridiques occitanes n’étaient plus que résiduelles au moment de l’Ordonnance. En tout cas un juriste contemporain comme Rebuffe, premier président du parlement de Paris, a interprété l’Ordonnance comme ne mettant nullement en cause les écritures occitanes. Ainsi Villers-Cotterêts est lui-même un mythe à déconstruire, comme j’ai essayé de le montrer ailleurs.
2- De même, Labouysse évoque en passant, le « francien », qui serait le français originel parlé en Île-de-France, imposé ensuite au fil des temps à tous le territoire. Or celui-ci, comme l’a montré Bernard Cerquiglini dans son livre récent, après Theodor Gossen et Anthonij Dees, n’a jamais existé : il est une pure fiction de la linguistique historique du XIXe siècle. Le français n’est nullement le « patois » du bassin parisien, mais il se serait constitué à travers la pratique écrite, en divers lieux du royaume (y compris d’ailleurs en zone occitanophone) ainsi qu'en Bretagne et en Angleterre.
Mais, pour ne pas être piégé par les mythes, il faut véritablement se donner les moyens de les déconstruire et pour ce faire, on ne dispose de rien d’autre que des méthodes et de la pratique historiennes, et celles-ci ne pourront pas ne pas se retrouver en porte à faux, sinon en contradiction, avec les simplifications dont se nourrit l’idéologie, y compris celle à laquelle l’historien adhère lui-même.
L’âge d’or occitan : mythe alternatif
Ainsi, retrouve-t-on dans le texte de Labouysse la classique idéalisation de la civilisation et de la culture occitanes à la veille de la croisade contre les albigeois, où les cultures auraient cohabité harmonieusement. Cette histoire est en effet très riche, mais elle est évidemment elle-même traversée de conflits et de rapports de force qui interdisent à mon sens une (trop) facile idéalisation. Pour ne rien dire de l'exaltation de l'hérésie cathare, sur des principes largement étrangers au catharisme réel. Mais l’Occitanie a elle-même besoin de ces mythes fondateurs… Le grand royaume des Wisigoths, les cathares, les troubadours, les comtes de Toulouse, les républiques communales… Ainsi, Labouysse collecte-t-il, tous les éléments permettant, dans l’histoire des espaces occitanophones, de trouver la préfiguration des idéaux éthiques et politiques contemporains qui animent Peuples et Régions solidaires, comme beaucoup d’autres groupes. Certes, il est essentiel pour nous, qui refusons d’être les clones de la capitale, de retrouver une fierté culturelle et linguistique après ces longs siècles d’humiliation et de dépression. Celle-ci peut-elle faire l’économie de l’élaboration d’un discours mythique alternatif ? On ne peut se réapproprier son histoire, et donner un sens à cette démarche, sans élaborer un imaginaire, qui déborde de tous côtés ce que l’histoire peut assurer. Peut-on élaborer un imaginaire attractif qui ne soit pas celui d’un récit mythique ? Il me semble que cela est possible... Nous avons dans notre tradition culturelle une arme puissante pour nous protéger des mythes nationaux : l’autodérision ; faisons en bon usage…
Labouysse fait état de ces chartes communale, où apparaissent des formules républicaines… Soit cette magnifique phrase des Fors de Bigorre (1097) : « Nous qui valons chacun autant que vous et qui réunis, pouvons plus que vous, nous vous établissions notre seigneur, à condition, que vous respectiez nos droits et privilèges, sinon Non ». Mais je ne vois guère par contre de filiation directe entre l’esprit de cette charte et les formulations républicaines de la Révolution française invoquée par l'auteur. Il est d’ailleurs intéressant de voir qu’il a existé un grand courant de républiques communales dans toute l’Europe à la fin de l’époque médiévale, et qu’il n’y a là, nullement, une spécificité occitane… Le lien qui unit le républicanisme moderne à ce passé communal est fort complexe et certes pas univoque.
Dans le même ordre d’idée, avancer que les notions occitanes de libertat, paratge et amor se concrétiseront plus tard dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (p. 31), me paraît une affirmation non étayée. Rien en effet ne me semble plus éloigné de l’éthique révolutionnaire que les valeurs de paratge et d’amor, telles qu’elles sont mobilisées dans la poésie des troubadours, qui appartiennent fondamentalement à l’univers de la féodalité (le « paratge » est d’abord l’expression de la dignité nobiliaire et de l’éthique chevaleresque qui va avec ; on ne peut rien imaginer de plus éloigné de l’égalité républicaine) ; de même que la valeur de « libertat », revendiquée par les communes médiévales, est on ne peut plus loin de la « liberté », non pas d’abord commune et communale, mais bien individuelle, la liberté du « citoyen » garantie par la loi, de la Déclaration des droits de l’homme (« La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui »). C’est sur ce principe là que s’appuient aujourd’hui nos revendication linguistiques, bien évidemment. Autrement dit, force est de constater que la condition de possibilité de nos revendications se trouve précisméent dans ce moment de l’histoire où fut décrété justement la mort de nos langues ; ce paradoxe mérite d’être médité, et nous montre toute l’impureté de l’histoire, dont nous devons nous pénétrer si nous voulons échapper à la logique délétaire du mythe.
Jean-Pierre Cavaillé
[1] Ma réflexion.
[2] Comme on le voit, le midi est pour Renan, une partie de la France avant même d’être annexée. Bon exemple du mythe de l’éternité de la France.
[3] Qu’est-ce qu’une nation ?, 1996, p. 227-8. Voir aussi, le texte en ligne.
[4] « Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un devoir vis-à-vis des races inférieures. […] Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures », débat parlementaire du 28 juillet 1885, cité p. 197.



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F20%2F115864%2F88771297_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F63%2F115864%2F88709368_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F05%2F115864%2F33743909_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F01%2F87%2F115864%2F33548531_o.jpg)