Le Sango sans peine
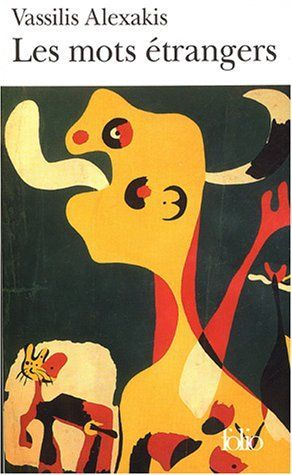
"Ne pas avoir de raison d’apprendre une langue n’est pas une raison de ne pas l’apprendre"
Je viens de lire en poche folio un roman écrit en français par l’écrivain grec Vassilis Alexakis : Les mots étrangers (2002)[1]. Il m’a enchanté. Il raconte l’apprentissage par le narrateur, un romancier hellène du nom de Nicolaïdès écrivant tant en français que dans sa langue maternelle (comme Alexakis, dont il semble d’ailleurs avoir écrit les romans ! Le pacte fictionnel est ici très mince), d’une troisième langue, choisie de manière presque casuelle : le sango, langue véhiculaire de la République centrafricaine. L’adage sur lequel il fonde sa décision et son assiduité mérite d’être médité : « Ne pas avoir de raison d’apprendre une langue n’est pas une raison de ne pas l’apprendre »[2]. Le tour de force consiste, de manière très simple et immédiate, à rendre la langue présente, dès les premiers mots et jusqu’au bout du livre, qui se termine par de petites phrases en sango non traduites. Le lecteur, au fil de sa lecture, sans s’en rendre compte, partage ainsi l’initiation du narrateur. et il n'a en effet plus besoin de la traduction pour les phrases finales. Le roman raconte comment Nicolaïdès décide d’apprendre une langue africaine, son choix quasi fortuit du sango, son apprentissage solitaire et rêveur, soutenu par la relation qu’il noue en France avec un linguiste centrafricain voué corps et âme à sa langue, et surtout, surtout, sa rencontre enfin, in vivo, avec le monde des locuteurs lors de son voyage à Bangui (Alexakis écrit Bangi, conformément à l’écriture du sango).
yekeyeke, na wuruwuru pepe
Au départ le narrateur veut apprendre la langue pour elle-même et ne songe nullement à se rendre en Afrique. Il apprend du vocabulaire, s’initie à une syntaxe et une grammaire parfois déconcertante pour un indoeuropéen, s’initie aux tons, susceptibles de changer le sens des énoncés. Il est d’abord frappé par l’imagination poétique et la beauté musicale des mots : kekereke (prononcer kèkèrèkè), qui est l’onomatopée du chant du coq, signifie demain ; kutukutu, la voiture ; wuruwuru, le bruit ; « tout doucement, sans faire de bruit », comme dit la chanson bien connue, se traduit en sango : yekeyeke, na wuruwuru pepe... Mais le lexique d’emblée dit aussi la misère, une situation politique, le poids de la colonisation encore omniprésent. Par exemple dans le mot qui signifie prostituée, gba-munzu, où munzu veut-dire Blanc, parce que dérivé de « bonjour » (le Blanc est celui qui dit sans arrêt munzu), de sorte que, littéralement, gba-munzu veut dire : « qui couche avec le Blanc ». Également édifiant le mot erepefu, travail forcé, qui est en fait le sigle du RPF, le Rassemblement du peuple français, le parti fondé par de Gaulle au début des années 50, alors qu’à Bangui, « les compagnies concessionnaires continuaient à sévir ». Le dictionnaire, remarque le narrateur, « m’apprend autant sur le pays que sur la langue ».
Le vocabulaire renvoie bien-sûr à la fois à l’histoire et la réalité humaine de Centrafrique. « Les mots, dit le narrateur lorsqu'il est encore à Paris, me font penser à des immigrés qui ressassent leurs souvenirs : ils me parlent de leur pays sans réussir à me communiquer leur nostalgie ou leur détresse ». Ce sentiment d’irréalité est évidemment une invitation au voyage. D’ailleurs, remarque-t-il, « j’ai le sentiment qu’elle est à l’étroit dans mon appartement […]. Le sango doit se demander par moments ce qu’il fait là, à Paris, chez un Grec ». Aussi Nicolaïdès se rend-il en Centrafrique sous le vague prétexte de donner quelques conférences sur son œuvre littéraire. Mais son but est bien de soumettre sa langue apprise sur les livres à l’épreuve du réel, et il y va un peu comme à un rendez-vous amoureux qu’auraient précédé de longs échanges épistolaires. On pouvait croire que ce locuteur en chambre allait forcément être pris en défaut de compréhension et surtout déçu par cette rencontre effective. Ce n’est néanmoins pas du tout ce qui se passe : il se lance, certes il ne comprend pas toujours (surtout les disputes), mais il se fait comprendre, on lui répond… Il arrive même à échanger des saluts avec les piroguiers de l’Oubangui, dont on dit qu’ils sont les inventeurs du sango.
« Les langues qu’on n’enseigne pas deviennent bêtes »
Mais surtout, avec tous, linguistes, fonctionnaires français et centrafricains, il discute du statut de cette langue ; ses propres observations et réflexions, ainsi que les échanges qu’il rapporte recoupent nombre de fois les discussions qui nourrissent ce blog. Alexakis lui-même est amené à comparer la situation diglossique du sango face au français en Centrafrique avec le mépris dans lequel en Grèce fut tenu si longtemps le démotique, parlé par le peuple (comme son nom l’indique) par rapport au catharévoussa (langue savante proche de l’ancien grec). Mais il compare aussi ce statut dégradé à la dévalorisation de ce qu’il appelle « langues régionales » en France.
Apprenant tout d’abord que le sango est langue officielle en République centrafricaine, Nicolaïdès croit un instant qu’il s’agit de « la langue du pouvoir » ; ce à quoi son savant interlocuteur lui répond : « Détrompez-vous […]. L’expansion du sango a été assurée par les commerçants et les missionnaires, qui passaient forcément par le fleuve pour pénétrer à l’intérieur du pays. Malgré sa popularité, et bien qu’il constitue le lien le plus sûr entre les diverses ethnies du pays, il n’est pas enseigné dans les écoles, où l’on n’apprend que le français, comme sous l’administration coloniales. Le sango est traité par le pouvoir comme une langue subalterne, vulgaire ». L’auteur du dictionnaire sango / français utilisé par le narrateur (un bien modeste ouvrage comparé aux neuf gros volumes du Grand Robert offert au narrateur par un ami), nommé dans le roman Marcel Alingbindo, fait le constat suivant : « nos écrivains ne s’expriment qu’en français ! Ils rêvent d’être publiés à Paris et lisent les suppléments littéraires des journaux français. Il n’existe que peu de textes en sango, la Bible mise à part. Je viens de terminer la traduction de la Déclaration des droits de l’homme[3]. Je suis continuellement obligé d’inventer des mots nouveaux ». Le mot même de « colonie » n’avait pas de traduction en sango, le dictionnaire propose kodoro-va : « pays serviteur ». Le mot même de « dictionnaire » était sans équivalent ! Le linguiste se souvint d’un personnage légendaire, un « génie qui avait une grosse tête et qui était censé tout savoir. Ce génie s’appelait Bakari » ; le mot était trouvé… « Nous nous sommes aperçus que la langue souffrait de lacunes considérables […]. Nous avons donc entrepris de la réinventer. Cette tâche m’a mobilisé pendant quarante ans… […] – Vous êtes des poètes [s’exclame le narrateur]. – Pas du tout ! Nous cherchons des solutions qui existent, qui sont déjà là en quelque sorte mais que personne n’avait encore enregistrées. La langue a prévu son évolution… ». Ces lacunes sont d’abord dues au fait que la langue est absente de l’enseignement et très peu utilisée à l’écrit, le français occupant toute la place de l’expression savante légitime : « Exclu de l’école, poursuit Alingbindo, le sango a pris du retard. Pas autant cependant que les langues régionales en France. Aux élections de 81, les candidats qui tenaient des meetings en français se faisaient huer. A la télévision et à la radio on utilise les deux langues ». En France, sans doute y a-t-il plus de productions écrites dans les langues minoritaires qu’en Centrafrique, mais leur usage oral est moribond. C’est hélas aussi le cas de centaines de langues africaines (l’Afrique compterait environs deux mille langues, soit un tiers des langues parlées sur la planète), mais non du sango qui jouit d’une bonne vitalité.
On ne s’étonnera donc pas qu’Alexakis, en fait son prête-nom Nicolaïdès – mais personne n’est dupe – éprouve la plus grand défiance envers la « francophonie » et le statut d’écrivain francophone qui lui colle malgré lui à la peau. Il soupçonne que les fonctionnaires de la francophonie ne s’intéressent pas à ses livres mais, dit-il, uniquement au fait « que j’en ai écrit quelques-uns en français ». Aussi, confronté à une fonctionnaire des Affaires Étrangères qui lui prépare son voyage, il n’hésite pas à lui lancer comme un reproche que « les jeunes Centrafricains n’ont toujours pas la possibilité d’étudier leur langue maternelle à l’école. Ils reçoivent la même éducation qu’avant l’indépendance, qui tend à les déposséder de leur culture. Il me serait très douloureux d’écrire en français si j’avais dû renoncer au grec. Je peux faire l’éloge de l’étude des langues, pas celui de leur oubli ». Mais il se trouve que cette personne lui avoue que sa langue maternelle est le corse : « … je ne l’ai jamais étudié sérieusement, dit-elle enfin. Croyez que je le regrette profondément. Je ne sais plus dire que deux, trois choses en corse. Les langues qu’on n’enseigne pas deviennent bêtes. La croisade de l’État français contre le corse ou l’occitan, qui dure depuis 1880, me paraît aberrante. Je crois que mes compatriotes seraient devenus de bien meilleurs citoyens français si la France avait respecté leur culture… ». La fonctionnaire reste bien, finalement, parfaitement dans son rôle, même dans ce mea culpa convenu et inutile (le narrateur, il est vrai, ne semble pas recevoir ses paroles de la même façon que le lecteur qui signe ces lignes).

Bangui et l'Oubangui
Sango, démotique et langues régionales
Une fois à Bangui, le narrateur en tout cas se rend parfaitement compte du caractère éminemment politique de la diglossie défavorable au sango, en Centrafrique comme en France. Soit, l’échange suivant avec Sammy, écrivain d’expression française et ancien ministre de Centrafrique :
« – Je n’ai pas vu un seul mot écrit en sango depuis que je suis arrivé, observé-je.
– Nous n’avons jamais appris à écrire notre langue, dit Sammy. Il n’existe pas de manuels scolaires en sango, nos instituteurs n’ont pas été formés pour l’enseigner. Son introduction dans les écoles demanderait un effort considérable que nos politiques ne sont pas prêts à soutenir. Ils se rendent bien compte qu’ils ont besoin du sango pour communiquer avec la population, toutefois ils ne le possèdent pas toujours très bien. Leur français est meilleur. Autoriser l’enseignement du sango reviendrait à reconnaître le droit du peuple à la parole. La majorité des élèves ont des difficultés avec le français, qu’ils entendent pour la première fois à l’âge de six ans. Seuls les plus doués parviennent à le maîtriser. ». Lui-même a par contre constaté, à l’occasion d’une expérimentation bilingue, que « les élèves qui étudient le sango en même temps que le français deviennent meilleurs en français que ceux qui apprennent exclusivement cette langue ». Nous connaissons ces arguments, qui nous permettent de valoriser nos rares écoles bilingues, sans que nous n’arrivions cependant à faire véritablement évoluer les instances pédagogiques qui, en France comme en Centrafrique, sont bien sûr au service du personnel politique au pouvoir.
Les moments clé du roman, pour le sujet qui nous occupe ici, sont les comptes rendus des discussions de l’auteur à Bangui, lors de deux rencontres mémorables avec des écrivains, intellectuels et dignitaires centrafricains et européens, l’une la Maison des jeunes, l’autre au Centre culturel.
Lors de la première soirée, Nicolaïdès fait part de son expérience de bilinguisme : en Grèce, il pense en grec, en France, au moins quand il écrit, en français… Un auteur centrafricain, Adrien, déclare par contre : « je pense en sango et j’écris en français ». Un ami lui rétorque que pour écrire français, il lui faut bien penser en français, mais Adrien insiste : « j’élabore mes projets en sango ». Le narrateur lui demande alors pourquoi il n’écrit pas en sango : « Qui me lira en sango ? Le français me donne accès à un véritable public, il répercute mes propos à l’infini ! ». Mais un autre auteur intervient et déclare avoir publié un petit roman en sango, La Reine du fleuve : « Il existe bel et bien un public pour le sango, à condition de lui proposer des livres bon marché ». L’écrivain grec se souvient alors que « la littérature populaire grecque était diffusée jusqu’aux années 60 essentiellement sous la forme de fascicules vendus dans les kiosques à journaux. », accompagnée du plus grand mépris des élites gagnées au catharévoussa. L’auteur de La Reine du Fleuve plaide en faveur de l’usage de sa langue maternelle : « Elle me laisse les mains plus libres que le français. Elle n’est pas encombrée de références, elle encourage l’improvisation. Elle me permet en même temps de mieux parler de la Centrafrique que je ne pourrais le faire en français. ». Le même, lors de la seconde rencontre, à la Maison de la culture, beaucoup plus officielle, fait alors fait remarquer au ministre qui honore la soirée de sa présence « que les insuffisances du sango étaient dues précisément au fait qu’il n’était pas enseigné » : « en lui refusant l’accès à l’enseignement vous le condamnez à prendre le retard que vous lui reprochez ». « Jamais, dit le narrateur à ce moment précis, je ne m’étais senti aussi proche du sango, je croyais entendre battre son cœur » et il s’enhardit à tenir au public les mots suivants : « En Grèce, les tenants de la langue érudite qui s’était imposée dans les écoles soutenaient que le jargon populaire était incapable de rendre compte des bouleversements de l’époque. Depuis qu’il est devenu la langue officielle du pays, ce jargon a largement fait la preuve de son aptitude à aborder tous les sujets ». Il faut dire qu’il avait commencé la soirée en prononçant lui-même quelques phrases de sango.
Un os attaché au cou
Alexakis confie à un certain « étudiant », au cours de ces deux soirées, le soin de porter les affirmations les plus audacieuses : « Avez-vous oublié que le français a été l’instrument de notre asservissement ? Que cette langue n’a cessé de nous susurrer que notre culture ne valait pas grand-chose, que nous étions des moins que rien ? Qu’elle a réussi à nous en convaincre, puisque nous continuons à reproduire son discours ? Il y a trop peu de temps que j’ai quitté l’école pour avoir oublié la punition que l’on m’avait infligée après m’avoir pris à parler en sango dans la cour. On ne m’a pas attaché d’os au cou, comme cela se faisait naguère, mais on m’a obligé à écrire mille fois « Je ne parlerai plus en sango ». Je ne peux pas aimer une langue qui m’impose le silence ». Lors de la seconde rencontre, alors que l’ancien ministre propose à son confrère en fonction l’institution d’une journée nationale du sango, le même étudiant déclare que « les personnes surprises en train de parler en français ce jour-là devraient être affublés d’un os attaché à leur cou », proposition évidemment jugée du plus mauvais goût, en particulier par la femme de l’ambassadeur français.
La pratique du signal : voilà encore qui rapproche Africains et « provinciaux »… Et il est vrai qu’il serait bien difficile de jeter la pierre au gouvernement de Centrafrique, vu qu’en France, il n’est pas même question de consacrer une journée symbolique, ni une heure seule, d’ailleurs, aux langues régionales, méprisées entre toutes les langues, dans un pays où l’on a pourtant le mépris linguistique facile. Ne parlons bien sûr pas de l’officialité reconnue au sango en Centrafrique, du moins formellement : on devra ici se contenter de la mention patrimoniale dans la Constitution, qui s’accommode fort bien, on le voit ces jours-ci, des décisions des tribunaux administratifs contre les panneaux bilingues de Villeneuve Lès Maguelone (Vilanòva-de-Magalona) ou l’ouverture d’une classe bilingue en Alsace.
Voilà comment le livre d’Alexakis, en partant très loin au pays du sango, nous parle en même temps de nos propres difficultés et de notre propre combat. Marcel Alingbindo, le spécialiste du sango installé en France, y déclare : « nous n’avons que cette langue […]. Si elle meurt, nous sommes perdus. Elle seule sait qui nous sommes, elle nous le rappelle chaque matin. Sans elle nous sommes condamnés à être réveillés par des voix étrangères ». Sammy, l’écrivain francophone, dit la même chose : « Le sango est peut-être notre dernier rempart. Les peuples privés de langue sont des peuples sans défense ». Nous avons eu nous-mêmes un prix Nobel qui disait : « Quau ten la lengo ten la clau que di cadeno nous desliuro ». Ces mots, hélas, au point où nous en sommes, paraissent quelque peu grandiloquent, la clé ayant été manifestement perdue, avalée avec la « fumée du train de Paris », comme disaient ici les vieux pour moquer l’accent « pointu » affecté par la jeunesse moderne.
Pour aller plus loin…
Ce n’est cependant pas sur cette note amère que je veux terminer, mais plutôt en disant que le roman d’Alexakis, par bien des aspects n’en est pas vraiment un, qui donne les moyens de passer de la fiction, où l’on commence à s’initier au sango sans s’en aviser, à la réalité de la langue enseignée et parlée. Le roman renvoie en effet à un site http://sango.free.fr/ qui existe vraiment et où en effet sont dispensés des cours de sango. Dans le livre, est aussi évoqué l’engagement du narrateur, avec l’aide des responsables culturels français de Centrafrique, dans un projet de « publication de petits textes en version bilingue ». Cet ouvrage est effectivement paru en 2007 : il s’agit d’un recueil de nouvelles bilingue sango / français intitulé Âtënë tî Bêafrîka / Paroles du cœur de l’Afrique. Il rassemble sept auteurs et est préfacé par Alexakis lui-même. Enfin, surtout, derrière le nom de Marcel Alingbindo, on retrouve en deux clics sur internet le nom de Marcel Diki-Kidiri, chercheur au CNRS, auteur infatigable de dictionnaires et de manuels de sango[4] ; c’est lui apparemment qui a créé et gère le site d’apprentissage de la langue. Il est en outre l’auteur d’une plaquette, téléchargeable sur le site de l’UNESCO, disponible en 4 langues, intitulée Comment assurer la présence d'une langue dans le cyberespace ? Il y avance la notion de langues « peu dotées », un peu trop large d’ailleurs me semble-t-il[5] (parmi lesquelles il n’oublie pas de signaler le breton, l’occitan et le basque) et propose des solutions pratiques pour leur graphie et leur usage sur la toile. L’initiative est bien sûr extrêmement intéressante et je remercie Alexakis de m’y avoir conduit sans le vouloir en même temps qu’il me faisait découvrir le monde du sango et de la Centrafrique.
Jean-Pierre Cavaillé
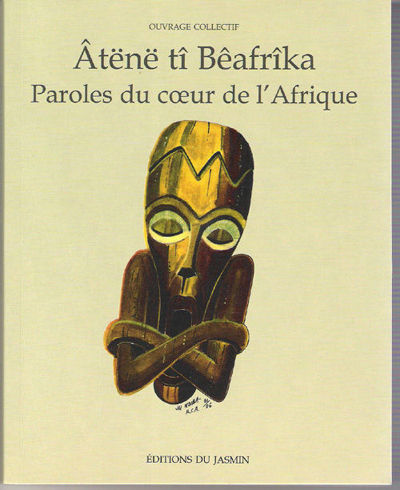
[1] Alexakis vient de faire paraître un nouveau roman, de taille considérable, dédié aux hypothèses, scientifiques ou non, concernant la première langue de l’humanité et le premier mot jamais prononcé par un homme. Il s’intitule, justement, Le Premier mot.
[2] En réalité, Alexakis, dans les interviews qu’il a donnés, reconnaît qu’en apprenant le sango, il avait l’intention d’écrire un roman dont le personnage principal serait justement cette langue même.
[3] On trouve sur Wikipedia le début de la Déclaration en sango.
[4] Voir par exemple le Dictionnaire orthographique du sängö, 1998.
[5] « Qu’est-ce qu’une langue peu dotée ? Il s’agit d’une langue qui ne dispose pas suffisamment, voire pas du tout, des ressources essentielles dont sont généralement dotées les grandes langues du monde, à savoir : une orthographe stable dans un système d’écriture donné, des ouvrages de référence (grammaires, dictionnaires, ouvrages littéraires), des œuvres de diffusion massive (presse écrite et audiovisuelle, films, chansons et musique), des ouvrages techniques et d’apprentissage (publications techniques et scientifiques, ouvrages didactiques, manuels), divers supports de communication du quotidien (affiches, publicités, courriers, notices, modes d’emploi, etc.), ainsi qu’un nombre abondant d’applications informatiques dans cette langue. Sur le plan des ressources humaines, une langue peu dotée peut devenir une langue en danger de disparition si elle n’est plus parlée que par un petit nombre de locuteurs. Il devient alors nécessaire pour la sauver, d’augmenter le nombre de ses locuteurs en l’enseignant par tous les moyens techniques possibles. On peut citer en Europe le breton, l’occitan ou encore le basque, en Amérique, la quasi-totalité des langues amérindiennes, en Asie, le myanmar, pour n’en citer qu’une parmi des centaines, en Océanie, la quasi totalité des langues autochtones des îles polynésiennes, micronésiennes et mélanésiennes. En Afrique, où se parlent un tiers des langues du monde, soit environ 2000 langues, les langues les mieux dotées (afrikaans, kiswahili, hausa, etc.) se comptent sur les doigts d’une main et font partie des langues émergeantes, donc des langues peu dotées. »



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F87%2F41%2F115864%2F57661938_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F69%2F38%2F115864%2F56954410_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F07%2F115864%2F129307937_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F51%2F75%2F115864%2F129234890_o.jpg)