La langue vivante selon Michel Serres
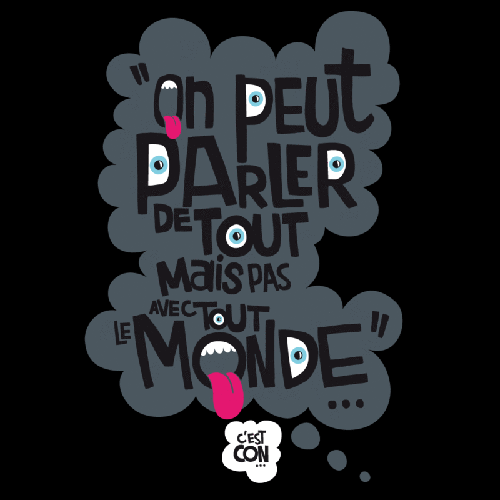
Graphisme de Philippe Monnerie
La langue vivante selon Michel Serres
Le philosophe Michel Serres, éminent membre de l’Académie Française, natif d’Agen, dont il a su conserver l’accent, a récemment participé au tollé provoqué par l’article 2 du projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, prévoyant l’élargissement de la pratique de cours en anglais dans nos universités (essentiellement pour attirer des étudiants étrangers). France Culture a diffusé, le 19 mai dernier, une courte intervention que je reproduis dans son intégralité :
« Il faut savoir ce que c’est qu’une langue vivante. Une langue vivante est une langue qui peut tout dire, et une langue qui ne peut pas tout dire est une langue virtuellement morte. Par exemple les langues régionales, comme le gascon, ou la langue d’oc, le breton, etc. sont virtuellement morte parce qu’elles ne peuvent pas tout dire. Elles ne peuvent pas dire la biochimie, les mathématiques, les techniques l’informatique, etc. bon, donc si à un certain moment on enseigne en anglais les disciplines considérées, c’est-à-dire les techniques, les sciences, etc. la langue française ne pourra plus tout dire… et par conséquent, elle sera virtuellement morte comme les langues régionales ».
Ce raisonnement à la va comme je te pousse est un tissu de lieux communs qu’il vaut la peine de détricoter ; car selon la manière de les interpréter, soit le propos apparaît purement conservateur, sinon réactionnaire, soit il est proprement révolutionnaire. Se pose aussi, selon l’une et l’autre option, la question de la validité linguistique et sociolinguistique de ces affirmations à l'emporte-pièce.
Nous pouvons nous accorder sur la proposition générale : une langue vivante est une langue « qui peut tout dire », à condition de préciser que ce sont ceux qui la parlent, les locuteurs, qui peuvent dire tout ce qu’ils veulent dire, et que « tout » n’est pas une totalité absolue, mais relative au monde de connaissance des locuteurs. Tout dire en France au XVIe siècle, n’est pas la même chose que tout dire à Rome au temps de Cicéron ou tout dire lorsqu’on appartient à une société amazonienne sans contact avec l’extérieur (s’il en est encore). Mais bon, ainsi relativisée, accordons avec cette majeure : une langue vivante peut tout dire.
Mais il faut maintenant s’entendre sur ce que pouvoir veut dire : s’agit-il de la capacité d’une langue à tout dire, ou la permission, le droit qui lui est donné et que se donnent les locuteurs de tout dire avec elle ? C'est-à-dire le pouvoir, au sens politique du terme, dont elle est investie et chargée, de tout dire ? Tout le propos de Serres repose sur cette ambiguïté, sur cette équivoque entre capacité et autorisation, puissance et pouvoir.
Si Serres veut dire que certaines langues, prises à un moment « t » de leur évolution, peuvent tout dire, comme le français, encore mais pas pour longtemps, et d’autres non, comme les langues régionales (je laisse de côté la distinction pour le moins maladroite entre gascon et langue d’oc, que ne reconnaîtrait pas même le plus radical des gasconisants hostiles à l’occitan), alors nous sommes dans le premier cas de figure : le français doit lutter pour conserver le monopole public de tout dire, du moins en France (car la question territoriale se pose immédiatement, même si elle n’est pas évoquée) ; l’État français doit lutter bec et ongle contre la pénétration de l’anglais, langue des plus dangereuses, parce que « pouvant tout dire ». Quant aux langues régionales, privées depuis longtemps de leur capacité de tout dire, elles sont « virtuellement » mortes et n’ont plus qu’à attendre leur disparition définitive.
Certes, l’expression « virtuellement » mortes n’est guère satisfaisante, parce que toute langue est mortelle, même les plus puissantes, aujourd’hui comme hier, celles qui « peuvent tout dire ». Mais manifestement, pour Serres, le critère de cette mort virtuelle est précisément le fait de ne pouvoir tout dire. Mais alors, les contre-exemples viennent en foule : le français avant le XVIe siècle n’était pas la langue de la philosophie, de la théologie et des sciences, prérogatives presque exclusives du latin. Pourtant le français était en plein essor et s’apprêtait à conquérir l’un après l’autre tous les domaines du savoir (de l'époque, en cette partie du monde, doit-on préciser). A cette époque là, l’occitan, dans lequel auparavant on avait pu écrire deux siècles avant, de manière certes marginale par rapport au latin, des textes de médecine, de mathématique, de théologie, face à la fois au latin et déjà au français n’était plus considéré comme « pouvant » (je conserve ici l’ambiguïté) dire ces sciences. Pourtant, il s’est maintenu extrêmement vif (c’est-à-dire qu'il était parlé par la quasi totalité des populations du sud de la France) pendant quatre siècles. Ce n’est pas mal pour une mort virtuelle (et annoncée) ! D’autres langues se sont maintenues plus d’un millénaire (comme les langues amérindiennes) sans accéder à l’écriture et sans exprimer les savoirs principalement véhiculés par les livres, et qui pourtant, une fois établi un système d’enseignement peuvent, comme les autres, dire la mathématique et l’informatique.
Car, ce que nous apprend la linguistique, c’est qu’une langue peut toujours tout dire, qu’elle en possède la capacité et que ce sont les conditions sociales et politiques de ses locuteurs qui décident de ses domaines d’usage. Descartes écrit latin pour la Sorbonne, français pour « l’honnête homme », mais il a montré qu’il pouvait développer les mêmes idées (ou du moins sensiblement les mêmes) dans les deux langues. Le maquignon naguère encore parlait occitan sur le champ de foire, français au juge, mais il est clair qu’il aurait pu faire l’inverse, si la possibilité s’en offrait.
L’expérience d’interlocution la plus simple le montre suffisamment : interrogez dans sa langue un locuteur d’une langue moribonde, d’une langue qui ne peut presque plus rien dire, questionnez-le sur son métier, sur la politique, sur la religion, sur la vie et sur la mort… et même, évidemment, sur les mathématiques et la biochimie, s’il pratique ses sciences (cela bien sûr peut se produire). Il vous répondra sans hésiter et en trouvant les mots (les empruntant quand il le faut à la langue dominante) dans la langue, prouvant ainsi que toute langue à tout moment peut tout dire.
Par contre toute langue n’a certes pas la possibilité sociale de tout dire, au sens où les paysans de naguère se seraient moqués du maquignon qui leur aurait parlé français et le juge se serait fort irrité que le même homme, sachant le français, lui eusse parlé « patois » ; si je propose un ouvrage de philosophie écrit en occitan à la maison Vrin, il y a fort peu de chance pour que l’éditeur me le publie et j’aurais les pires ennuis si je décidais de délivrer mes cours en occitan dans un département d’histoire ou de philosophie, alors que je vais avoir, que j’ai déjà en fait depuis longtemps, le droit de les donner en anglais. De ce point de vue d'ailleurs, les propos de la ministre au sujet de l'anglais, n’effectuent qu’un rattrapage des pratiques et des exigences effectives.
Si c’est cela que veut nous dire Serres, alors ses propos sont vraiment révolutionnaires. Il voudrait alors dire sa crainte de voir le français privé du droit de parler de biochimie et l’exemple des langues régionales tendrait à montrer qu’elles sont en grand péril parce qu’on ne leur laisse plus rien dire et, à la fois, que les locuteurs eux-mêmes ne s’autorisent plus à parler que de manière quasi clandestine, dans leurs relations privées les plus étroites. Il voudrait donc dire qu’un tout autre sort est possible pour ces langues si on leur reconnaissait (et si les locuteurs se reconnaissaient) d’autres espaces d’expression légitime.
Mais non, il ne dit pas cela : il ne peut pas vouloir dire cela, parce qu’il conçoit l’enseignement en anglais de certaines matières, même non exclusif, comme une atteinte aux capacités d’expression du français. Octroyer des droits aux locuteurs des langues minorées reviendrait donc sans doute aussi pour lui à attenter au français (c’est en tout cas la position de l’Académie française à laquelle il appartient), mais alors ce qui est en cause n’est pas un pouvoir tout dire, mais le « pouvoir », au sens politique du terme, de faire taire les autres langues, fût-ce au prix d’un double déni de réalité. Car Serres sait bien que les colloques internationaux – et même s’ils ont lieu en France – se font en anglais et que cela n’empêche nullement les chercheurs, en d’autres circonstances, de formuler leur savoir dans leur langue maternelle… et bien sûr éventuellement dans les autres. La réalité déniée, c’est à la fois l’imposition planétaire de l’anglais comme langue de communication des savoirs, et le fait évident que cette langue n’est nullement en mesure de revendiquer le monopole de l’expression de ces savoirs, justement parce que, à tout moment, toute langue peut tout dire, et il sera donc toujours possible de parler de biochimie en français, tant que le français existera. Ce qui pourrait advenir, c’est que l’usage de parler de biochimie en français soit interdit par la loi ou par la coutume, mais nous n’en sommes certes pas encore là !
Par contre, effectivement, les langues régionales en sont là, et depuis des siècles. Ce n’est d’ailleurs certes pas cela qui les tue, mais le fait que l’espace public et domestique de leur usage se rétrécisse comme une peau de chagrin, à la fois pour de complexes raisons sociales et culturelles, mais aussi pour des raisons politiques et légales que je ne veux ici ni minimiser, ni maximiser. Une chose est certaine, en tout cas, si vous voulez parler de biochimie en occitan avec vos amis, cela est possible, évident, immédiat, il suffit pour cela de connaître la langue ; la question de vocabulaire (c'est-à-dire du lexique) est toujours seconde, secondaire, rien n’est plus facile que d’emprunter les mots qui manquent au français, à l’anglais ou au chinois s’il le faut !
Jean-Pierre Cavaillé
PS) Ma lecture est amplement confirmée par le texte d’une intervention de M. Serres à l’ENS de la rue d’Ulm à Paris, le 13 mai 2008, retranscrit partiellement sur un forum (abc de la langue française). Dans ce texte, le philosophe ayant rappelé qu’il a été nourri « en gascon, c’est-à-dire dans un patois d’Occitanie », définit une langue régionale, carrément comme une langue attaché à une seule « région cognitive », une langue qui ne parle que « d’une région du sens » et « ne peut pas s’exprimer en une autre région du sens ». L’argumentation, confusionniste et fallacieuse de bout en bout, est critiquée très finement par l’internaute transcripteur (greg), qui affirme contre Serres et ses exemples que « toutes les langues peuvent créer, utiliser puis recycler/bannir <nucléotide> et <octaèdre> pourvu que l’usage le veuille. D’ailleurs ces mots grécolatins existent bel et bien en occitan ». Il en vient ainsi, et à juste titre, à dire que Serres – comme tant d’autres – confond langue et lexique.
Michel Serres en habit vert. On aperçoit derrière Hélène Carrère-d'Encausse




/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F51%2F75%2F115864%2F129234890_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F71%2F26%2F115864%2F127660018_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F50%2F02%2F115864%2F93693891_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F35%2F115864%2F91749327_o.jpg)